|

Une grande crise. Symptômes de mort.
 Vers la
fin du mois d’avril 1937, j’ai eu une grande crise [physique] que me mit aux
portes de la mort: des vomissements à ne plus en finir; mon estomac n’acceptait
aucun aliment. Les premiers jours je suis restée dans un profond abattement. Je
ne reconnaissais personne. Je n’avais ni faim ni soif. Monsieur le curé, par
trois fois, me récita les prières pour les agonisants, mais je m’en souviens
très peu. J’entendais que l’on priait, mais je ne pensais pas à la mort. Vers la
fin du mois d’avril 1937, j’ai eu une grande crise [physique] que me mit aux
portes de la mort: des vomissements à ne plus en finir; mon estomac n’acceptait
aucun aliment. Les premiers jours je suis restée dans un profond abattement. Je
ne reconnaissais personne. Je n’avais ni faim ni soif. Monsieur le curé, par
trois fois, me récita les prières pour les agonisants, mais je m’en souviens
très peu. J’entendais que l’on priait, mais je ne pensais pas à la mort.
Depuis un an, je recevais régulièrement la Communion ,
alors qu’auparavant, malgré la peine que cela me causait, je ne la recevais que
quelques fois par mois.
Je ne sais pas pourquoi, mais probablement parce le Seigneur l’inspira à l’abbé,
celui-ci me portait Jésus chaque jour. J’avais demandé cette grâce qui fut pour
moi une très grande joie.
Pendant cette période de ma maladie, — je ne sais pas si le matin ou
l’après-midi — j’ai vu entrer dans ma chambre monsieur le Curé. Le
reconnaissant, je lui ai dit : — « J’aimerais recevoir Jésus. » Il m’a répondu :
« — Oui, ma chère, je vais prendre une hostie non consacrée : si tu ne la
rejettes pas, je te donnerai Notre Seigneur. » Et ce fut ainsi. Toutefois, à
peine avalée, je l’ai rendue aussitôt. Le Père était d’avis de ne pas me donner
la Communion, mais quelqu’un lui dit : « — Monsieur le Curé, une hostie non
consacrée n’est pas Jésus ! » Alors il se décida à me donner la Communion et je
ne l’ai pas rendue. Je ne suis plus jamais restée sans la Communion. Combien de
fois le curé en entrant, me trouvait prise de crises de vomissements ! Mais, à
peine avais-je reçu Jésus, que les crises et les nausées cessaient, pour ne
revenir qu’une demi-heure après la Communion. C’est par cette raison que
Monsieur le Curé ne craignait plus de me donner Jésus.
La crise dura pas mal de temps et, pendant dix-sept jours je n’ai rien pu
avaler: ma médecine était Jésus.
Je disais : « — Je meurs de faim et de soif » — car après les premiers jours, je
sentais une soif brûlante et un grand besoin de m’alimenter. Quand j’en fus
guérie, ma plus grande peine me venait lorsque je pensais que, si j’étais morte
pendant cette crise, je n’aurais pas eu une parfaite connaissance de la mort.
La protection dévoilée de Jésus et de Marie
Lors des festivités du mois de mai dans la paroisse, je restais seule à la
maison. Pour faire mes prières, j’allumais quelques bougies à l’aide d’une tige.
Un jour, un bout de bougie allumée est tombé risquant de faire prendre feu à la
nappe de la table ou faire éclater le globe de verre. Je voulais l’étendre avec
la canne, mais je n’y réussissais pas. Au moment ou je m’apprêtais à laisser
tomber dessus le chandelier, tout s’est éteint. Quelle affliction de ne pas
pouvoir bouger et empêcher qu’une aussi petite flamme ne cause la destruction de
notre maison !
Un autre jour où je devais aussi rester seule pour peu de temps, j’ai eu une
grande peur. Une voisine est entrée pour me demander si j’avais besoin de
quelque chose. Quand elle est partie, elle a laissé la porte de la véranda
ouverte et, peu de temps après, notre chèvre en a profité pour entrer. Elle a
pris la direction de la salle où nous gardions les vases de fleurs destinés à
l’ornementation de l’église, les jours de fête. Je l’ai appelée : elle m’a
regardé, mais n’est pas venue. Je lui ai jeté un morceau de miel, mais elle ne
l’a pas mangé, je lui ai encore montré un autre bon morceau et j’ai continué de
l’appeler; à la fin, elle a fini par s’approcher de moi. Alors, je l’ai saisie,
je lui ai donné le miel et je l’ai ensuite tenue pendant deux heures :
quelquefois la caressant, quelquefois aussi lui administrant quelques petites
tapes. Quand ma sœur est arrivée, elle s’est étonnée que j’aie pu faire un tel
effort. J’ai remercié Jésus pour avoir pu éviter, malgré ma paralysie, le
désagrément de voir nos fleurs détruites. Combien je dois à Jésus ! J’étais
prisonnière au lit, mais il m’a épargné ce chagrin.
Quelque temps après, j’ai eu une épreuve plus douloureuse. Ma sœur s’était
absentée du village et ma mère était partie au marché. Je suis restée avec une
jeune fille chargée par ma mère de m’aider, jusqu’à son retour. Malgré ses vingt
ans, elle préféra s’en aller avant l’heure. Au moment où elle sortait, je lui ai
dit : « — Si vous voulez partir, faites-le. A leur retour, elles me retrouveront
ici, vivante ou morte. »
À peine la jeune fille était-elle sortie, que quelques chatons, après plusieurs
tentatives, réussirent à monter sur mon lit. Comme je ne le voulais pas, je les
ai obligés à descendre. Quelques minutes plus tard, j’ai entendu que l’un d’eux
tombait dans une bassine d’eau. Il a beaucoup miaulé et, après avoir avalé
beaucoup d’eau, il est mort. La mère a, elle aussi, beaucoup miaulé. Je n’ai pas
réussi à me dominer et j’ai commencé à pleurer, en disant : « — O Maman du ciel,
faites que quelqu’un arrive et puisse le sauver. J’ai invoqué plusieurs
saints. » En même temps je pensais : « — Malheureux, celui qui est
paralytique ! »
Par hasard, deux personnes sont entrées et, me voyant pleurer ont été
impressionnées, voyant mon affliction. Le chaton était mort. Je ne me suis pas
impatientée. Je ne pleurais parce que j’avais de la peine pour les animaux, mais
je n’ai pas offensé Jésus. Ce fait fut à l’origine des grandes afflictions
morales, parce que ma mère et ma sœur prirent très mal le comportement de la
jeune fille. Mais elles lui ont pardonné, comme moi aussi, je lui ai pardonné.
Comme j’aimais la solitude, spécialement le dimanche, lorsque, à l’église se
faisait l’adoration du Saint-Sacrement, je demandais aux miens de me laisser
seule avec Jésus.
C'est ainsi, qu'un jour, aussitôt que je les avais entendues partir, je m'étais
mise à réciter mon chapelet. Peu après, j'ai entendu ouvrir le portail qui donne
dans le jardin et des pas légers arpenter les escaliers, en même temps qu'une
voix répétait avec insistance : « — Ouvre-moi la porte ! » D'immédiat j'ai
reconnu cette voix
et, j'ai tremblé apeurée. Qu’en serait-il de moi s’il réussissait à entrer !
Avec confiance, j'ai serré entre mes mains le chapelet, mais j'étais atterrée,
en pensant à ce qui pourrait m'arriver. J'entendais pousser fortement la porte
et manœuvrer la serrure. Je tremblais, sans même oser respirer, car je savais
que la porte n'était pas fermée à clef. Mais, je ne sais comment, la porte ne
s'est jamais ouverte. Après de vains essais, le voyou a renoncé et est parti, me
laissant en paix. Après une aussi grosse frayeur, jamais je n'ai voulu rester
seule à la maison.
J'attribue à Jésus et à la Mère du Ciel la grâce d'avoir été épargnée de cette
mauvaise rencontre, car j’aurais de loin préféré être attaquée par une foule de
démons [que par cette personne].
Premier examen du Saint-Siège
Le 1er mai 1937, j’ai eu la visite du révérend Père Durão. Il était
envoyé par le Saint-Siège afin
 d’examiner
la question de la consécration du monde à Notre-Dame. Je ne désirais pourtant
que vivre cachée, sans que personne sache ce qui se passait en moi. Le révérend
remis à ma sœur un billet de mon directeur spirituel, lui demandant de me le
lire. En entendant les mots du billet — qui étaient les suivants : « Je vous
présente le révérend Père Durão ; parlez-lui librement et répondez à tout ce
qu’il vous demandera » —, je me suis affligée et j’ai demandé à ma sœur : « Que
dois-je lui répondre ? » Car je ne savais pas qu’un interrogatoire était
nécessaire pour des cas comme le mien. Ma sœur m’a encouragée en me disant : « —
Dis-lui ce que Notre-Seigneur t’inspirera ». d’examiner
la question de la consécration du monde à Notre-Dame. Je ne désirais pourtant
que vivre cachée, sans que personne sache ce qui se passait en moi. Le révérend
remis à ma sœur un billet de mon directeur spirituel, lui demandant de me le
lire. En entendant les mots du billet — qui étaient les suivants : « Je vous
présente le révérend Père Durão ; parlez-lui librement et répondez à tout ce
qu’il vous demandera » —, je me suis affligée et j’ai demandé à ma sœur : « Que
dois-je lui répondre ? » Car je ne savais pas qu’un interrogatoire était
nécessaire pour des cas comme le mien. Ma sœur m’a encouragée en me disant : « —
Dis-lui ce que Notre-Seigneur t’inspirera ».
J’ai été surprise, par la manière dont, sans hésitation, j’ai répondu aux
questions au sujet des communications de Notre-Seigneur. Il m’a suggéré de ne
lui dire que les choses principales, afin de ne pas me fatiguer. Je lui ai
répondu que je ne savais pas quelles étaient les choses principales. Le révérend
me dit alors : « — J’aime ça ! J’aime ça ! » Et ce fut alors qu’il m’a parlé de
la consécration du monde à Notre-Dame. Après quelques questions il m’a dit : « —
Vous ne vous trompez pas ? » À ces paroles, je me suis souvenue de mon erreur au
sujet de ma mort et, j’ai pensé : « — Une fois déjà, je me suis trompée... » Et
je lui ai raconté ce qui s’était passé le jour de la fête de la très
Sainte-Trinité, en 1936. Le révérend Père ne m’a plus dit si je ne m’étais pas
trompée, mais il a repris : « — Ces choses-là coûtent beaucoup, n’est-ce pas ? »
Et je lui ai répondu : « — Oui, elles coûtent et me rendent triste. » Et j’ai
commencé à pleurer. À la fin, il s’est recommandé à mes prières et m’a assuré
qu’il ne m’oublierait pas non plus, lors de la célébration de la sainte Messe.
Il s’est agenouillé ensuite et a récité trois Ave et quelques prières
jaculatoires. Celles-ci terminées, il a pris congé. J’ai beaucoup pleuré, et je
suis restée dans la tristesse et la tourmente, car ce qui pendant longtemps
était resté caché et gardé au sein de la famille, sortait ainsi à la lumière.
Tout de suite j’ai écrit à mon directeur spirituel pour tout lui raconter. Il
m’a répondu rapidement en me rassurant, me disant que tout cela servait pour la
plus grande gloire de Notre Seigneur.
Période pendant laquelle
le démon m’a le plus
importunée
Si la vie matérielle s’est améliorée pendant cette période, les assauts du démon
qui depuis des mois me menaçait, redoublèrent. Ce fut au mois de juillet 1937
que le « manchot »,
non content de me tourmenter la conscience et de me dire des turpitudes, après
quelques mois de menaces, a commencé de me battre et à me faire tomber du lit,
de jour comme de nuit.
Au début j’ai caché la chose y compris aux personnes de la maison, excepté ma
sœur, leur disant qu’il s’agissait de crises du cœur. Mais, par la suite, ma
mère et une jeune fille
qui vivait avec nous, ont été informées. Les personnes qui étaient témoins de
mes chutes avaient de la peine pour moi, mais ignoraient tout à fait leur
origine. Une nuit, le malin m’a jetée sur le parquet, me faisant passer
par-dessus ma sœur qui dormait sur un matelas étalé par terre à côté de mon lit.
Deolinda s’est levée, m’a prise dans ses bras m’ordonnant : « — Va dans ton
lit ! » Remise à ma place, je me suis levée brusquement en émettant des
sifflements. À peine me suis-je rendue compte de ce qui arrivait, j’ai commencé
à pleurer et dis à ma sœur : « — Oh ! Qu’ai-je fait ?! » Elle m’a tranquillisée
en disant : « — Ne t’affliges pas : ce n’était pas toi ! » La nuit suivante la
même chose s’est produite et, à ma sœur qui voulait me reposer sur mon lit je
lui ai crié, en l’éloignant de moi : « — Non, non, au lit je n’irai pas ! » À
peine je me rendais compte du mal que je faisais, je pleurais.
Une nuit le « manchot » a fait les pires choses que l’on puisse imaginer, des
choses que je ne connaissais pas et même j’ignorais. Alors je pleurais amèrement
et pensais ne pas pouvoir recevoir mon Jésus, sans me confesser.
Ce jour-là, Monsieur le Curé était absent, mais je sentais qu’il me serait bien
difficile de lui parler de ces choses-là. Je sentais ne pas pouvoir m’ouvrir à
lui. Ma sœur qui, voyant mes larmes, cherchait à me réconforter par tous les
moyens, mais n’y réussissait pas, s’est proposée d’aller chercher mon directeur
spirituel qui prêchait dans un village voisin. Je lui ai dit que cela ne serait
pas nécessaire, car je ne lui dirais pas ce qui se passait. Je lui ai demandé
une image de Notre-Dame et, avec beaucoup de sacrifice, j’ai écrit succinctement
ce qui était nécessaire pour être comprise. Je l’ai cachée sous l’oreiller en
attendant que l’heure arrive de la remettre. Mais, de façon imprévue, mon
directeur spirituel est arrivé avec Jésus-Hostie, accompagné par un séminariste.
Il avait été informé de l’absence de Monsieur le Curé. Quand il m’a annoncé
qu’il m’apportait Jésus, je lui ai dit : « — Je ne peux pas faire la Communion
sans me confesser. »
Les larmes et la honte ne me permettaient pas de parler. Je lui ai dit,
toutefois, avoir écrit un billet. Il l’a pris, l’a lu et, pour me tranquilliser,
m’a assuré qu’étant donné les précédents, il avait prévu cette épreuve, même
s’il n’avait jamais osé m’en prévenir.
Cette tribulation s’est répétée plusieurs fois. J’étais victime des ces
furieuses attaques deux fois par jour, vers neuf ou dix heures de la nuit et
aussitôt après midi, et cela durait parfois plus d’une heure. Pendant ces
assauts je ressentais en moi la rage et la fureur infernales. Je ne consentais
pas que l’on me parle de Jésus et de Marie, ni même de voir leurs images : je
leur crachais dessus et les piétinais. Je ne pouvais pas non plus sentir la
présence de mon Directeur spirituel : je l’insultais et voulais même le frapper,
ainsi que quelques personnes de la maison. Mon corps devenait violet et
sanguinolent à cause des morsures.
Je disais pareillement des gros-mots envers les personnes présentes. Oh !
Combien j’aimerais que beaucoup aient pu le voir, afin qu’ils craignent l’enfer
et arrêtent d’offenser Jésus !
À chaque fois que l’influence du démon cessait et, me souvenant de tout ce que
je venais de faire et de dire, d’angoissants scrupules m’envahissaient ; j’avais
l’impression d’être la plus grande criminelle. Ce furent des mois de douloureux
martyre. J’aurais beaucoup à dire sur ce registre, mais je ne le peux pas : mon
âme ne résisterait pas à l’évocation de telles souffrances.
Jésus me montre ses divines plaies
Une nuit, Jésus m’est apparu: sur ses mains, sur ses pieds, sur son côté, il
portait ses plaies
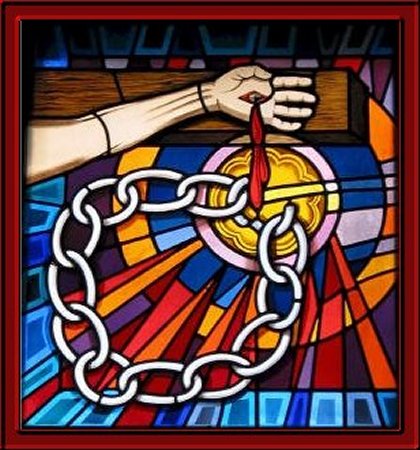 ouvertes,
très profondes, desquelles jaillissait, abondamment, du sang. De celle de son
côté, le sang coulait jusqu’à la ceinture, traversait la bande de lin et coulait
jusqu’à terre. J’ai baisé les plaies des mains avec beaucoup d’amour et je
désirais ardemment embrasser celles des pieds, mais, étant dans mon lit, je ne
le pouvais pas. Je n’ai rien dit, mais Il devina mon désir et m’accorda la
possibilité de le faire. J’ai ensuite fixé la plaie du côté. Pleine de
compassion, je me suis jetée dans les bras de Jésus, lui disant : « — O mon
Jésus, combien vous avez souffert par amour pour moi ! » Je suis restée ainsi
quelques instants, jusqu’au moment où Jésus a disparu. ouvertes,
très profondes, desquelles jaillissait, abondamment, du sang. De celle de son
côté, le sang coulait jusqu’à la ceinture, traversait la bande de lin et coulait
jusqu’à terre. J’ai baisé les plaies des mains avec beaucoup d’amour et je
désirais ardemment embrasser celles des pieds, mais, étant dans mon lit, je ne
le pouvais pas. Je n’ai rien dit, mais Il devina mon désir et m’accorda la
possibilité de le faire. J’ai ensuite fixé la plaie du côté. Pleine de
compassion, je me suis jetée dans les bras de Jésus, lui disant : « — O mon
Jésus, combien vous avez souffert par amour pour moi ! » Je suis restée ainsi
quelques instants, jusqu’au moment où Jésus a disparu.
Il est inutile de dire que plus jamais cette vision ne s’effacera de ma mémoire.
Aujourd’hui encore je sens mon cœur blessé, au souvenir de ce tableau. Je n’en
parle que par obéissance et par amour pour Jésus. Je pense qu’il a agi ainsi
pour me préparer à ce que maintenant je vais raconter : qu’Il m’en donne la
force et la grâce !
Le 23 juillet 1938 j’écrivais : « Jésus est ma force, mon amour, mon Époux.
Acceptez, ô Jésus, que votre toute petite fiancée vous dise, non pas des lèvres,
mais du cœur : Je n’appartiens qu’à vous !
Je n’ai rien, rien qui ne soit à Jésus.
Cela coûte de parler ainsi, alors que l’on ressent le contraire et que l’on vit
les heures les plus amères de sa vie, des journées de tant de luttes où le démon
m’affirme le contraire, rien que le contraire.
Maudit, je ne t’appartiens pas. Tu n’es digne que de mépris. Tu es menteur!
Jésus est tout à moi, et moi, je suis toute à Jésus. Mon cœur, mon cœur, crie
fort, très fort à ton Jésus et dis-lui que tu l’aimes, que tu l’aimes plus que
toutes les choses de la terre et du Ciel !
Je suis à Jésus dans les joies, dans les peines, dans les ténèbres, dans les
terribles tribulations, dans la pauvreté, dans l’abandon total.
Je souffre tout pour Jésus, pour le contempler, pour sauver les âmes.
Envoyez, ô Jésus, à votre Alexandrina, votre victime, tout ce que l’on peut
imaginer, tout ce qui existe et peut s’appeler souffrance. Avec Vous, avec votre
aide divine et avec celle de la votre et ma tendre Maman du Ciel, je vaincrai
toujours. Je ne crains rien.
Je t’embrasse et te serre dans mes bras, ô Croix bénie de mon Jésus !
[71]
Ma retraite spirituelle
Chaque fois que j’apprenais que certaines personnes faisaient leur retraite
spirituelle, je disais : « — Tout le monde fait sa retraite, sauf moi! Je ne
sais même pas ce que c’est. »
J’ai osé dire ceci plusieurs fois en présence de mon directeur spirituel. Il me
promit que si le Père provincial le lui permettait, il serait venu pour me la
faire. Par une grande faveur, le Seigneur, dans ses desseins, le permit. Ce fut
le 30 septembre 1938 que mon Père spirituel est venu la commencer.
À ce temps-là, mon âme se trouvait vivre dans de grandes agonies et, quelques
fois, je me sentais sur le point de tomber dans des abîmes épouvantables.
Pendant les jours de retraite, mes souffrances ont redoublé et ces abîmes sont
devenus terrifiants. La justice du Père éternel tombait sur moi et souvent me
criait : « — Vengeance, vengeance, etc. » — pendant que les souffrances du corps
et de l’âme augmentaient. Il est impossible de les décrire ; il est nécessaire
de les avoir senties et vécues. Je passais les jours et les nuits roulant sur
mon lit, en entendant la voix puissante du Père Éternel.
Au matin du 2 octobre 1938, Jésus m’a dit que j’allais souffrir toute sa sainte
Passion, du Jardin des Oliviers au Calvaire, sans aller jusqu’au “Consummatum
est”. Je devrais la souffrir le 3 et ensuite tous les vendredis juste après
12 heures jusqu’à 15 heures, mais que pour la première fois Il resterait avec
moi jusqu’à 18 heures pour me confier ses lamentations.
Je ne me suis pas refusée. J’ai informé mon directeur de tout ce que Jésus
m’avait dit. J’attendais le jour et l’heure, très affligée, car ni moi ni mon
directeur, nous n’avions aucune idée de ce qui allait arriver. Dans la nuit du 2
au 3 octobre, l’agonie de mon âme fut bien grande. La souffrance de mon corps,
fut-elle aussi très grande: vomissements de sang et douleurs terribles. Pendant
plusieurs jours j’ai vomi et pendant cinq jours, je n’ai rien avalé. Ce fut donc
avec cette souffrance que j’ai abordé ma première crucifixion. Quelle horreur je
sentais en moi! Quelle peur et quelle terreur! Mon affliction était indicible.
Juste après l’heure de midi, Jésus est venu m’inviter : « — Voilà, ma fille, Le
Jardin des Oliviers est prêt, ainsi que le Calvaire. Acceptes-tu ? »
J’ai senti que Notre Seigneur, pour quelque temps, m’accompagna sur le chemin du
Calvaire. Ensuite, je me suis sentie seule. Je le voyais là haut, grandeur
nature, cloué sur la Croix. J’ai cheminé sans le perdre de vue… je devais
arriver près de Lui.
[73]
J’ai vu deux fois sainte Thérèse.
La première fois à la porte du Carmel, dans sa tenue, entre deux autres sœurs,
puis entourée de roses et recouverte d’un manteau céleste.
NOTA : Étant donné qu’Alexandrina ne s’est
jamais disposée à décrire le phénomène de la Passion, nous transcrivons ici la
lettre suivante, adressée à son Directeur spirituel, où elle décrit les
sentiments de son âme pendant les heures qui précédaient la Passion.
Je cherche un peu de soulagement dans ma souffrance. J’attends l’heure de ma
crucifixion. Je ne peux pas parler. Mon cœur galope. Dans mon âme c’est la
rébellion, l’émeute. Le poids m’écrase. Ténèbres, nuit menaçante et triste ; je
me trouve dans un état d’abandon effrayant. Il me semble cheminer au milieu de
la haine de tous, de tribunal en tribunal. Pauvre de moi! Et je n’ai pas reçu
Jésus! J’ai confiance qu’il suppléera dans les Communions spirituelles,
nonobstant la nausée que je sens de moi-même et l’horreur pour mon énorme
misère.
Hier, la température s’est calmée. Au début je ressentais des choses horribles.
Mon corps était tout transpercé de long en large comme par d’aiguës pointes.
Quels terribles moments ! Malgré un court soulagement, je suis toujours restée
dans une nuit très obscure, dans une profonde tristesse. Je peux dire que je
suis restée toute la nuit à tenir compagnie à Notre Seigneur, me concentrant un
peu sur la tragédie de la nuit du jeudi saint. Il me semblait que Jésus
m’invitait au Jardin des Oliviers. Que de mouvements de foule ! Ces choses je
les ressentais dans mon âme.
Mon Père, tout ce que je dicte me semble mensonger. Combien de doutes ! Que
d’effroi à l’approche de la Passion ! J’ai déjà dit à Deolinda
que c’est un miracle que de pouvoir en résister : mon cœur ne bat presque plus.
Que Jésus soit avec moi. Je n’ajoute rien, parce que je ne le peux plus...
Ici, elle interrompt sa lettre, parce que la Passion commence alors. Sa sœur,
Deolinda nous la décrit comme suit :
« Mon Père, quel vendredi saint ! Ce fut vraiment le vendredi de la Passion !
Avant que celle-ci ne commence, combien son visage était empreint d’affliction !
Elle craignait ce jour et disait : « Combien j’aimerais qu’il soit déjà
passé ! » Je la réconfortais comme je le pouvais, la caressant, alors que
moi-même j’étais remplie de peur et d’affliction ?
Pendant la Passion, je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer et j’ai remarqué que
presque toutes les personnes présentes pleuraient. Quel spectacle émouvant !
L’agonie du Jardin des Oliviers, fut longue et afflictive. On entendait des
gémissements très profonds et à un certain moment, elle suait le sang. De la
flagellation, je ne vous en parle même pas, et non plus du couronnent d’épines !
Les coups de la flagellation la mirent à genoux; ses mains semblaient attachées.
J’ai voulu lui mettre un coussin sous les genoux, mais elle changea de place,
elle n’en voulait pas. Elle a les genoux en piteux état. Les coups sont
innombrables... elle les reçut pendant bien longtemps... Il fallait en arriver
là. Les coups de canne sur la tête couronnée d’épines, furent aussi très
nombreux. Pendant la Passion elle vomit deux fois : uniquement de l’eau, car
elle n’avait rien à l’estomac. La sueur était si abondante que ses cheveux en
étaient trempés. En passant la main sur ses vêtements, j’ai pu constater qu’ils
étaient aussi tout trempés.
À la fin du couronnement d’épines elle ressemblait à un cadavre.
Le chanoine Borlido — de Viana do Castelo — et deux autres personnes, ainsi que
le docteur Almiro de Vasconcelos — de Penafiel — son épouse et sa sœur Judith,
étaient présents ».
Et Alexandrina poursuit :
Ma souffrance fut bien douloureuse, pendant quelques jours. Les vomissements de
sang et une soif brûlante continuèrent. Aucune eau n’était capable de ma
rassasier. Je ne pouvais pas boire... J’ai passé des jours ayant l’eau qui me
coulait sur les lèvres, mais sans pouvoir l’avaler.
[76] J’étais fatiguée et les personnes qui m’assistaient
étaient elles aussi fatiguées. Alors même qu’une grande quantité d’eau était
passée sur mes lèvres, j’en demandais encore : « — Donnez-moi de l’eau, beaucoup
d’eau, des sceaux d’eau ! » — J’avais l’impression de brûler : aucune eau me
rassasiait.
Je sentais des odeurs horribles. Je ne voulais pas que les personnes
s’approchent de moi : elles sentaient comme des chiens morts. On de donnait des
violettes et des parfums à sentir, mais ils éloignaient tout : la même puanteur
me tourmentait toujours.
Les jours où je pouvais prendre quelques aliments, ceux-ci avaient pour moi un
si mauvais goût que j’avais des nausées : toutes ces choses exhalaient des
odeurs répugnantes.
Combien de choses j’aurais à dire si je pouvais décrire tout ce que je ressens !
Il m’en manque le courage, car il est très pénible de remémorer toutes ces
choses.
Doutes et scrupules de tromperie.
Examens médicaux et théologiques
En même temps que les grâces divines augmentaient, augmentaient aussi les doutes
et la peur
 de me
tromper et de tromper mon Directeur ainsi que tous ceux qui vivaient autour de
moi. Mon martyre augmentait, lui aussi, de plus en plus : il me semblait que
tout était faux et inventé par moi. Mon Dieu, quel coup pour mon cœur ! Les
ténèbres m’enveloppaient : je n’avais aucune lumière pour me montrer le chemin.
Mon Directeur faisait pourtant bien des efforts pour me redonner confiance, mais
rien n'y réussissait. de me
tromper et de tromper mon Directeur ainsi que tous ceux qui vivaient autour de
moi. Mon martyre augmentait, lui aussi, de plus en plus : il me semblait que
tout était faux et inventé par moi. Mon Dieu, quel coup pour mon cœur ! Les
ténèbres m’enveloppaient : je n’avais aucune lumière pour me montrer le chemin.
Mon Directeur faisait pourtant bien des efforts pour me redonner confiance, mais
rien n'y réussissait.
Malgré cela, je me faisais violence pour m’abandonner dans les bras de Jésus,
afin de ne pas être prise dans le tourbillon.
Je souffrais beaucoup à cause des larmes de ceux qui m’entouraient et, je
pensais : « — Mon Dieu, si le courage leur manque, comment n’en manquerai-je
pas ? »
Quelle humiliation je ressentais d’être observée par d’autres ! O, si seulement
je pouvais souffrir seule et que ce soit Jésus le seul à savoir combien je
souffrais pour Lui !
Aussitôt après la deuxième crucifixion, les examens, faits par des Père de la
Compagnie [de Jésus], ont commencé. Quelle honte j’ai éprouvé, non pas pendant
la Passion, mais avant et après !
J’ai commencé à comprendre que mon Directeur spirituel souffrait beaucoup,
intimement, à cause de moi, c’est-à-dire, en voyant tout ce qui arrivait.
[79]
Les examens des théologiens ont été suivis par ceux, très douloureux, des
médecins,
lesquels laissaient mon corps en piteux état. J’avais l’impression de
comparaître devant un tribunal, comme si j’avais commis les plus grands crimes.
Combien il m’était pénible de les voir entrer dans ma chambre, m’examiner et
ensuite se réunir dans une salle pour discuter sur mon cas, me laissant sous le
poids de la plus grande humiliation !
Si je ne me trompe pas, ce fut à partir de la troisième crucifixion que les
médecins sont venus examiner mon cas. C’est difficile et je sais que je ne peux
pas décrire toute ma souffrance. Ils laissaient mon corps martyrisé, mais
d’autres choses m’étaient encore plus pénibles. Quelle humiliation j’ai dû
subir ! Quelle triste figure je faisais devant eux ! Pas même le plus grand
criminel n’aurait pas été jugé par un tribunal avec autant de soin. Si je
pouvais ouvrir mon âme afin que l’on puisse voir ce qui se passe en elle et ce
que j’ai vécu quotidiennement — car je revis ces jours ! — je le ferais pour le
bien des âmes, en dévoilant combien je souffrais pour l’amour de Jésus et pour
elles. Ce n’est que pour cela que je me suis soumise à de telles souffrances.
Quand mon Directeur m’a proposé ces examens, il m’a laissé entendre que je ne
serais examinée que par les médecins ; ce fut pour moi un grand déchirement ;
une forte répulsion a jailli en moi. Je voulais souffrir cachée, que seul Jésus
connaisse ma souffrance. Mais l’obéissance commande. Je me suis réprimée et je
les ai acceptés pour Jésus. Il ne manquait plus que des médecins pour compléter
mon calvaire ! Certains ont été pour moi de vrais bourreaux placés sur ma route.
Ceux-ci, après leurs consultations, ont décidé de m’envoyer à Porto. Ce fut très
difficile pour moi de m’y soumettre étant donné mon état de santé. Je craignais
ne pas pouvoir faire le voyage et, lorsque le médecin assistant
m’y invita, je lui ai répondu : « — Vous-même, en 1928, vous ne m’avez pas
autorisé à aller à Fatima, et maintenant, alors que je suis bien plus
souffrante, vous voulez m’envoyer à Porto ? » Il a répliqué : « — C’est vrai que
je ne l’ai pas voulu, mais maintenant je le veux. » Je lui ai demandé si mon
Père spirituel était au courant de cette décision. M’ayant répondu par
l’affirmative, j’ai cédé à sa requête.
Le 6 décembre 1938, vers onze heures, j'ai été transportée de mon lit à
l’ambulance. Dans la matinée, plusieurs personnes amies sont venues me rendre
visite ; presque toutes ont pleuré ; il en était de même pour ma famille. En ce
qui me concerne, j’avais cherché à toutes les égayer, faisant semblant ne rien
souffrir. Le voyage fut douloureux. Il nous a pris presque trois heures et
demie, car nous devions faire plusieurs pauses, à cause de mon état de santé.
[82]
À Porto, dans le cabinet du docteur Roberto de Carvalho on m’a fait passer une
radio. Il m’a traitée avec beaucoup de délicatesse et, en me donnant congé, il
m’a dit : « — Pauvre fille, combien tu souffres ! »
De là j'ai été envoyée au Collège des Filles de Marie Immaculée, où j'ai été
très bien traitée. Par contre, à cause des chaos de la route, j’ai failli
m’évanouir, plus d’une fois. J’ai été examinée par le docteur Pessegueiro : cela
n’a servi qu’à augmenter ma souffrance.
[83]
Le voyage de retour a été très pénible, lui aussi. À peine rentrée dans ma
petite chambre, j’ai été entourée par des personnes amies.
Le 26 décembre 1938, j’ai reçu la visite et subi les examens du docteur Elísio
de Moura, lequel m’a traité cruellement, en essayant violemment de me faire
asseoir sur une chaise. N’y réussissant pas, il me jeta sur le lit, faisant
plusieurs expériences qui toutes m’ont beaucoup fait souffrir. Il m’obstrua la
bouche, me jeta contre le mur, sur lequel je me suis cognée avec force. Me
voyant presque évanouie, il m’a dit : « — O ma Jeannette, ne tombe pas dans les
pommes ! »
Sans le faire exprès, j’ai pleuré, mais toutes mes larmes et mes souffrances,
très nombreuses, je les ai offertes à Jésus. Ce que j’en dis là est loin de la
réalité. Je lui ai tout pardonné, parce qu’il venait en mission d’étude.
Le 5 décembre 1939, Monsieur le Curé, accompagné de Monsieur le chanoine Vilar,
sont venus me visiter. Ce dernier, les présentations faites, est resté seul avec
moi, pour me parler.
Nous avons parlé des choses de Notre Seigneur, pendant deux heures. Ensuite, il
m’a parlé du but de sa visite, en commençant ainsi : « — Ma visite vous paraîtra
certainement étrange, car vous ne me connaissez pas. »
J’ai souri et je lui dis ensuite : « — Je sais, certainement, pourquoi vous êtes
venu. » Aussitôt il ajouta : « — Dites, dites, Alexandrina. » Je me suis
expliquée : « — Vous êtes envoyé par le Saint-Siège. C’était ce que je
ressentais dans mon âme à ce moment-là. « — C’est exact. » Et il m’a présenté
quelques documents de Rome, et ensuite m’a posé quelques questions auxquelles
j’ai répondu rondement. Je ne lui ai pas parlé de la Passion, par contre, lui,
il m’en a parlé. « — Il me semble que quelque chose vous arrive depuis quelques
mois... » Il a manifesté le désir d’y assister. Et, en effet, il est venu y
assister le vendredi suivant.
J’ai parlé de cela à mon directeur, lequel m’a conseillé de m’ouvrir à lui avec
franchise. Le chanoine est revenu quatre fois, mais, pour sa mission, que deux
fois. Si je ne me trompe, dès la première fois, il me dit : « — Notez,
Alexandrina, j’aurais préféré vous connaître dans d’autres circonstances, avant
que je ne vienne, chargé d’une mission, comme ce fut le cas. » Il m’a confié le
secret de son départ pour Rome, duquel, seul l’Archevêque était au courent.
Étant donné que je me sentais bien à l’aise pour parler avec lui et, ayant la
permission de mon Père spirituel, nous avons beaucoup parlé de Jésus : je me
suis sentie enveloppée dans une atmosphère de sainteté et de sagesse, comme bien
peu de fois cela arrive, en conversant avec d’autres prêtres. Je lui ai avoué
que, par tempérament, je n’avais pas l’habitude de procéder de la même manière
avec les autres, mais que lui, il m’inspirait confiance. Il m’a répondu : « —
Vous faites bien de ne pas en parler : ils ne le comprendraient pas. »
Quand il a pris congé de moi pour s’en retourner à Rome, j’ai pleuré. Il m’a
promis de m’écrire et m’a demandé d’être sa médiatrice sur terre.
J’ai, en effet, reçu de lui plusieurs lettres, auxquelles j’ai répondu : nous
nous sommes aidés mutuellement par des prières à Notre Seigneur.
Jésus me demandait de nouveau sacrifices. À cause des examens médicaux et de
l’intervention du Saint-Siège, mon cas est devenu plus connu : pour moi, qui ne
souhaitais que l’anonymat, cela fut un martyre !
Ma famille ne me rapportait pas les nouvelles qui circulaient, mais, malgré
cela, j’ai appris les commentaires que l’on faisait sur ma vie. Pauvres
ignorants, combien de mensonges ils diffusaient ! Quelques-uns affirmaient que
mon voyage à Porto avait pour but d’obtenir une pension mensuelle de la part de
Monsieur Oliveira Salazar [alors Président du Conseil portugais] ; ils parlaient
même de chiffres absurdes et discordants : 500 escudos pour les uns, 300 ou 200
pour les autres ; aucune tentative ne réussissait à faire taire de tels
mensonges.
D’autres encore, disaient que j’y étais allée pour « mesurer mon degré de
sainteté » sur une machine spéciale. Deolinda, pour faire terre cette version,
répliquait : « — Si cela était possible, j’irai moi aussi, pour contrôler à quel
point je le suis. »
J’éprouvais de la peine en constatant que les choses du Seigneur étaient si mal
comprises.
D’autres encore propageaient que les prêtres qui me rendaient visite,
recueillaient de l’argent dans les paroisses et me l’apportait et, que c’était
pour cela que rien ne manquait jamais chez moi.
Autres, pour en finir, disaient que je faisais la «voyante» : en effet des
personnes sont venues chez nous pour connaître leur avenir. Je les recevais avec
beaucoup de sérénité, feignant ne pas comprendre leur manège, mais quand elles
insistaient, je leur répondais : « — Je ne suis pas voyante, personne peut
deviner l’avenir. Nous n’avons pas le droit de pénétrer dans la pensée d’autrui.
Seul le Seigneur le connaît.
Et le temps passait ainsi.
Visite d’un médecin envoyé par Jésus
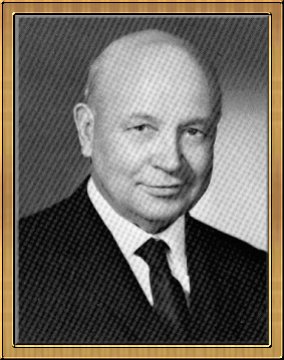 Le
29 janvier 1941, j’ai reçu la visite d’un Prêtre connu, lequel était accompagné
de plusieurs personnes de sa paroisse. Dès son arrivée, il me les a présentées,
mais ce n’est qu’après un long moment de conversation que j’ai appris que parmi
eux se trouvait un médecin. Sachant cela, je me suis sentie gênée, non pas que
je sois en train de mentir, en parlant de ma souffrance, mais bonnement parce
que je ne m’attendais pas à sa présence. Il est toutefois resté discret et
souriant. Je ne sais pas ce que je ressentais pour lui au plus profond de moi.
J’étais alors loin de penser qu’il deviendrait dans quelques instants mon
médecin traitant. Le
29 janvier 1941, j’ai reçu la visite d’un Prêtre connu, lequel était accompagné
de plusieurs personnes de sa paroisse. Dès son arrivée, il me les a présentées,
mais ce n’est qu’après un long moment de conversation que j’ai appris que parmi
eux se trouvait un médecin. Sachant cela, je me suis sentie gênée, non pas que
je sois en train de mentir, en parlant de ma souffrance, mais bonnement parce
que je ne m’attendais pas à sa présence. Il est toutefois resté discret et
souriant. Je ne sais pas ce que je ressentais pour lui au plus profond de moi.
J’étais alors loin de penser qu’il deviendrait dans quelques instants mon
médecin traitant.
Il a commencé à m’examiner minutieusement, mas avec beaucoup de prudence et de
tendresse. Son examen terminé, il lui a paru judicieux d’inviter le Dr Abel
Pacheco, jusqu’alors mon médecin traitant, afin de l’informer de son
diagnostique. Cela m’a peinée, car j’en avais assez d’examens médicaux, mais
j’ai cédé, ayant toujours en vue la volonté de Notre Seigneur et le bien des
âmes.
Le premier mai de la même année j’ai été examinée par le docteur Pacheco.
L’examen a duré peu de minutes, mais il a été la cause de grandes souffrances
pour mon corps et pour mon âme : pour le corps parce que ses mains semblaient de
fer ; pour l’âme parce que je ressentais déjà les humiliations et les résultats
de cet examen. Malgré cela, j’étais encore loin d’en voir le bout ! J’ai été
informée par le docteur Dias de Azevedo qu’il serait mieux que je retourne à
Porto afin de consulter le docteur Gomes de Araujo, si telle était la volonté de
Notre Seigneur.
[87] Il m’a suggéré de demander la lumière divine e, car il ne
voulait en rien contrarier le Seigneur.
Pendant un mois j’ai prié pour savoir si c’était bien là la volonté de Dieu.
Plus je demandais de la lumière et plus les ténèbres augmentaient et plus
profonde devenait la souffrance de l’âme, car je ne savais pas quoi faire.
Finalement, le Seigneur m’a dit que c’était sa divine volonté que je parte à
Porto.
[88]
Mon état physique était assez grave. Ils craignaient de me sortir de mon lit
pour un aussi grand voyage. Moi-même je craignais beaucoup : si, rien que le
fait de me toucher était cause de grandes souffrances, comment pouvais-je aller
aussi loin ?... Encouragée par les paroles de Notre Seigneur, j’avais confiance
en lui et sous sa divine action, je me suis préparée pour partir à l’aube du 15
juillet 1941.
À quatre heures, j’avais déjà fait mes prières. Pour montrer que j’en étais
contente, j’ai appelé ma sœur pour lui dire que “nous allions en ville” :
rien que pour cacher ma douleur. Pendant que je lui disais cela, j’ai entendu la
voiture qui arrivait chez nous.
Le docteur Dias de Azevedo et un monsieur de nos amis
sont entrés dans ma chambre. Après une courte conversation, pendant que ma sœur
s’habillait, nous nous sommes préparés pour partir. Nous avons pris la route à
4,30 heures, afin de ne pas alarmer la population ; il faisait encore nuit. En
effet, nous sommes sortis du pays sans rencontrer personne.
Mon âme était encore ans dans un plus grand silence ! Plongée dans un abîme de
tristesse, sans interrompre mon intime union avec Jésus, je voyageais Lui
demandant toujours davantage de courage pour les examens qui m’attendaient et en
offrant mon sacrifice afin d’avoir son divin Amour et pour les âmes. J’invoquais
aussi la Maman du Ciel et les saints qui m’étaient les plus chers. Rien ne
m’attirait et, tout ce que je voyais me causait une profonde tristesse. De temps
à autre ils interrompaient mon silence pour me demander si j’allais bien ; je
les en remerciais sans même sortir de l’abîme dans lequel j’étais plongée. Il
faisait jour déjà quand nous sommes arrivés à Trofa, chez la personne qui nous
accompagnait : là je devais me reposer et recevoir mon Jésus, en attendant de
repartir pour Porto. Avant de reprendre le voyage, j’ai été portée dans le
jardin de monsieur Sampaio et, soutenue par l’action divine, je me suis
approchée de quelques petites fleurs que j’ai cueillies en pensant : « — Le
Seigneur, quand Il les a créées, savait déjà qu’aujourd’hui je serais venue les
cueillir. » Ensuite j’ai été photographiée à deux endroits différents et, de
l’un à l’autre, je me suis déplacée toute seule, ce qui n’était plus jamais
arrivé depuis que j’avais pris le lit,
de la même façon que plus jamais je ne m’étais retournée dans mon lit sans aide
de quelqu’un. Ce fut un miracle divin, car sans lui, je n’aurais pas pu le
faire.
Nous avons repris le voyage : mon âme souffrait horriblement. À six kilomètres
de Porto, Notre Seigneur a retiré son action divine. J’ai commencé à ressentir
les habituelles souffrances physiques qui m’ont tourmentée jusqu’à la fin du
voyage. J’ai dit alors, non pas parce que je connaissais la distance, mais parce
que mon état me l’a fait dire : « — Nous sommes déjà proches de Porto. »
Quelqu’un a répondu : « — Nous arrivons, nous arrivons ! » En effet, j’avais pu
voir qu’il ne manquait plus que six kilomètres.
La sortie en voiture vers le cabinet a été douloureuse, autrement dit : martyre
pour le corps, agonie pour l’âme; il me semblait que j’allais mourir.
Avant d’entrer dans la salle des consultations, j’ai dit à celui qui me portait
dans ses bras : « — Posez-moi, posez-moi, même si c’est sur le carrelage ! » À
ce même moment le médecin est arrivé et il me fit coucher sur un brancard, où je
suis restée en attendant la visite. Quelques instants avant que je ne rentre
dans le cabinet, Jésus m’a libérée de l’agonie de l’âme, ne me laissant que les
souffrances physiques, afin que je puisse mieux résister.
L’examen a été assez long et douloureux. Pendant que je me déshabillais,
quelqu’un m’a dit de ne pas m’affliger. Moi, me souvenant ce que l’on avait fait
à Jésus, j’ai dit : « — Même Jésus a été déshabillé. » Et je n’ai pensé à rien
d’autre. Le docteur Gomes de Araujo, même si un peu brusque, a été prudent et
attentionné.
Pendant le retour à la maison, Jésus a exercé sur moi son action divine, afin
que je résiste au voyage, mais il m’a laissée de nouveau l’âme angoissée.
Arrivés à Ribeirão je suis allée me reposer chez le docteur Azevedo afin
d’attendre la nuit et de pouvoir rentrer au village sans que nul ne s’en rende
compte.
Que ce soit dans l’une comme dans l’autre maison, j’ai été traitée avec beaucoup
d’attentions, mais nul ne parvenait à me réconforter, alors même que je souriais
pour cacher le plus possible ma douleur. Il faisait déjà nuit quand nous avons
repris le voyage. Tout m’invitait à un silence de plus en plus profond. J’étais
indifférente à tout. Pendant le trajet, je n’ai rien vu d’autre que les fleurs
du jardin de Famalicão parce que quelqu’un me les avaient signalées. Nous sommes
arrivés à la maison à minuit, obtenant ainsi, que personne ne se soit rendu
compte de notre absence.
Après ce voyage, mes souffrances physiques ont assez augmenté. Tout ce que je devais souffrir le jour du voyage, Notre Seigneur
me l’a gardé pour le lendemain, allant de plus en plus mal.
Lettre à Notre Dame
 « Balasar, le 30 avril 1941 « Balasar, le 30 avril 1941
Chère Petit Maman
Pour entamer ton mois bénit, je viens demander ta bénédiction, ton amour, afin
que je puisse aimer le tien et mon bien-aime Jésus. Je veux l’aimer, beaucoup,
beaucoup, jusqu’à devenir folle d’amour ; je ne veux vivre et mourir que par
amour ! Aidez, ma tendre Petite Maman, votre Jésus à immoler et à sacrifier
celle qui veut donner son sang et sa vie pour les âmes et pour votre Jésus.
Donne-moi, ma tendre Maman, ta pureté, ton humilité, ton obéissance ; donne-moi
tes vertus afin que je sois sainte, afin de rendre gloire à ton Jésus pour
lequel seul je veux vivre.
Petite Maman, je te demande cette petite aumône du Ciel : je veux que le mois de
mai soit pour moi soit le dernier que je passe sur terre. Je veux aller
rapidement jouir de ton Jésus et de ta compagnie. Je veux continuer auprès de
toi à implorer pardon et miséricorde pour le monde qui est le tien. Ta fille la
plus indigne, la pauvre Alexandrina.
P. S. Je ferai tomber une pluie de grâces et d’amour sur tous ceux et celles
qui, sur la terre, me sont chers.
A jamais ta fille, Alexandrina.
Visite du Révérend Père Terças.
Conséquences de cette visite
Le 27 août 1941 j’ai reçu la visite de Monsieur le curé accompagné du Révérend
Père Terças et d’un autre prêtre. Cette visite fut pour moi très crispante,
parce que j’ai dû faire le sacrifice de répondre devant tous à une série de
questions du Père Terças. J’ai répondu consciencieusement à toutes les
questions, car j’ai pensé qu’il était venu pour faire une étude, comme d’autres
l’avaient fait. Cependant, le Seigneur seul sait combien cela m’a coûté de
devoir parler de la “Passion” ; et ce fut surtout sur celle-ci qu’il
m’interrogea.
Monsieur le Curé m’a dit que le Révérend désirait revenir vendredi, 29 août. Je
ne voulais pas y consentir sans consulter mon Directeur mais, m’ayant dit qu’il
devait repartir à Lisbonne ce jour-là,
j’ai cédé à sa demande, lui disant : « — Je pense que vous ne venez pas ici par
curiosité, n’est-ce pas ? » Ayant été rassurée sur ce point, j’ai accepté, même
si sa visite un vendredi me déplaisait assez.
Le Révérend ne manqua pas son rendez-vous, mais il est venu accompagné de trois
prêtres. J’étais bien loin de penser que cette visite me préparait un nouveau
calvaire : peu après il publiait tout ce qu’il avait vu et tout ce qu’il avait
appris sur moi.
[92]
Que Jésus accepte les souffrances qui m’ont été causées par cette publication
qui mit sur la place publique mes secrets cachés pendant de longues années.
De temps à autre, les commentaires qui étaient faits sur moi, me venaient aux
oreilles : c’étaient comme des épines que les gens involontairement
m’enfonçaient dans l’âme. Ceux qui lisaient cette revue-là ou écoutaient ce qui
se disait sur moi, avaient sur moi des idées diverses.
Mon voyage à Porto et la publication de ma vie inquiétèrent les esprits des
Supérieurs de mon Directeur spirituel au point de lui interdire de me visiter et
de me fournir l’assistance religieuse dont j’avais besoin ; ils lui interdirent
aussi de m’écrire et de recevoir des nouvelles de moi.
Après cela, j’ai commencé à vivre de leurres : mon Directeur spirituel,
viendra-t-il aujourd’hui, viendra-t-il demain ? Ma pensée était préoccupée par
mille et une choses. J’étais impressionnée me rappelant que je perdais mon temps
avec des choses inutiles, mais je n’arrivais pas à détourner mon esprit de ce
qui me faisait tant souffrir. Je passais quelques heures à me persuader que tout
pouvait arriver comme je le pensais. Un jour, je me suis persuadée que, n’ayant
pas été prévenue par mon Directeur spirituel, celui-ci viendrait célébrer la
Sainte Messe dans ma chambre. J’ai pensé : il viendra demain par le train, sans
me prévenir. Lorsque j’ai entendu le train s’approcher et arriver à l’arrêt,
j’ai cru qu’il s’était arrêté plus de temps qu’il n’en faut, et l’idée d’un
accident me traversa l’esprit : mon Directeur spirituel étant victime de cet
accident, pendant lequel il aurait perdu une jambe. Les gens voulaient le
conduire à Póvoa, mais le Révérend refusa, alléguant qu’il venait chez moi,
qu’il fallait qu’il soit conduit en ma présence. Je me suis imaginée le voir
entrer dans ma chambre, porté par diverses personnes : il semblait moribond.
L’une des personnes portait sa jambe coupée. Quand ce tableau si vivant et
saisissant s’est présenté à mon âme, j’ai eu l’impression de me mettre à genoux
devant Notre Dame et de crier vers Elle : « O ma Petite Maman, montrez ici votre
pouvoir », en lui recollant la jambe. Après cela, j’ai conjecturé qu’il n’était
pas venu chez nous, mais qu’il avait été ramené à l’hôpital. Cela ayant été su,
j’ai eu comme le sentiment que ses frères en religion se réjouissaient et
disaient : voilà la preuve évidente que Notre Seigneur ne voulait qu’il aille
auprès d’elle.
Des absurdités comme celles-ci, j’en ai eu d’autres, mais qui ne m’ont pas fait
autant souffrir.
Ma vie a été tout entière une vie de sacrifice ; je peux presque dire que je ne
sais pas ce que c’est que jouir pleinement de la vie, ce qui ne me cause
d’ailleurs aucun regret. Je me sens à la fin de ma vie et, si à la peine d’avoir
offensé Notre Seigneur j’ajoute la jouissance du monde, qu’elle horreur cela
représente pour moi. N’avoir joui que du péché, quelle horreur.
J’aspire après l’éternité, car là seulement je saurai remercier Jésus de m’avoir
choisie pour vivre cette vie de sacrifice, désireuse toujours d’aimer Jésus et
de sauver les âmes.
Je sais que très peu personnes me comprendront, mais à moi, une seule chose me
suffit : Jésus comprend tout.
Mon testament
Mon désir est que mon enterrement soit pauvre. Je veux que mon cercueil soit
d’un type ni trop beau ni trop faible, afin de ne pas attirer l’attention de
personne. Je veux être habillée en blanc, comme « Fille de Marie », mais très
modeste. Toutefois je sais que j’ai une robe très belle, meilleur que celle que
j’avais prévue : on me l’a offerte et, comme je n’ai pas de volonté propre,
parce qu’elle est plus parfaite, j’accepte ce qu’on a bien voulu me donner.
Si cela n’est pas interdit par la Sainte Église, je veux beaucoup de fleurs sur
mon cercueil. Non point que je les mérite, mais bien parce que je les aime
beaucoup. S’il s’agissait de mérite, je n’aurais droit à rien.
Ma volonté est d’être mise en terre, sans cercueil en plomb. Je ne veux pas non
plus de grandes cérémonies, car ma mère n’en a pas les moyens.
Sur le trajet de mon enterrement je souhait le plus grand recueillement. J’ai
beaucoup de peine quand je regarde ou quand j’entends parler de la manière
d’accompagner les convois funèbres.
Je ne veux pas d’autopsie ; mon corps exposé en vie aux regards des médecins
suffit largement.
Sur ma tombe
 Je veux
être inhumée, si possible, le visage tourné vers le tabernacle de notre église.
De la même manière que pendant ma vie je n’ai eu d’autre désir que celui d’être
tout près de Jésus au Saint-Sacrement et me tourner vers le tabernacle aussi
souvent que possible, ainsi après ma mort, je veux continuer à veillez sur le
tabernacle et à rester tournée vers lui. Je sais qu’avec les yeux de mon corps
je ne vois pas mon Jésus, mais je veux rester ainsi afin de mieux prouver
l’amour que j’ai envers la divine Eucharistie. Je veux
être inhumée, si possible, le visage tourné vers le tabernacle de notre église.
De la même manière que pendant ma vie je n’ai eu d’autre désir que celui d’être
tout près de Jésus au Saint-Sacrement et me tourner vers le tabernacle aussi
souvent que possible, ainsi après ma mort, je veux continuer à veillez sur le
tabernacle et à rester tournée vers lui. Je sais qu’avec les yeux de mon corps
je ne vois pas mon Jésus, mais je veux rester ainsi afin de mieux prouver
l’amour que j’ai envers la divine Eucharistie.
Je veux qu’autour de ma tombe on plante des martyrs, afin que par cette plante
on sache que les ayant aimés en vie, je les aime après ma mort. Intercalés aux
martyrs je veux des petits rosiers grimpants, de ceux qui ont beaucoup d’épines.
J’aime et j’aimerai la vie durant les martyrs que Jésus me donne et les épines
qui me blessent et je les aimerai après ma mort. Je les veux près de moi, pour
montrer que c’est par les épines et tous les martyrs que nous ressemblons le
plus à Jésus, que nous consolons son divin Cœur et que nous sauvons des âmes,
filles de son Sang. Quelle plus grande preuve d’amour pouvons-nous donner à
Notre Seigneur sinon acceptant avec joie ce qui est douleur, mépris,
humiliations ? Quelle plus grande joie pouvons-nous procurer à son divin Cœur
sinon en lui donnant des âmes, beaucoup d’âmes pour lesquelles il a souffert et
donné sa vie ?
Sur ma sépulture je veux aussi une croix et, près de celle-ci une image de ma
bien-aimée Petite Maman. Si cela est possible, j’aimerais qu’une couronne
d’épines entoure cette croix. La croix signalera que je l’ai portée la vie
durant et que je l’ai aimée jusqu’à la mort. La Petite Maman c’est pour montrer
que ce fut elle qui m’a aidée à monter le chemin douloureux de mon calvaire,
m’accompagnant jusqu’aux derniers moments de ma vie. J’ai confiance qu’il en
sera ainsi. Elle est Mère, et en tant que Mère, elle ne me laissera pas seule
aux derniers instants de ma vie.
J’aime Jésus, j’aime la Petite Maman, j’aime la souffrance, et ce n’est qu’au
Ciel que je comprendrai la valeur de toute ma souffrance !!!
Quarante jours passés à Foz (1943)
Pour satisfaire aux désirs de Monseigneur l’Archevêque,
[93] je me suis soumise à un autre examen médical qui a eu
lieu le 27 mai de cette année [1943]. Quand celui-ci m’a été annoncé,
une nouvelle souffrance s’empara de mon esprit. Mais voyant en tout cela la très
sainte Volonté de Dieu, comme toujours, par obéissance, bien qu'un nouvel examen
médical fût pour moi bien pénible, j’y ai consenti. Lors que j’ai appris la date
de celui-ci, j’ai ardemment prié la très Sainte Vierge de me donner la sérénité
nécessaire pour tout supporter avec courage et résignation, pour Jésus et pour
les âmes.
Le jour fixé, mon médecin traitant, le docteur Manuel Augusto Dias de Azevedo,
le docteur Henrique Gomes de Araujo, et le professeur Carlos Lima,
[95] sont venus chez nous. Je suis restée calme et sereine ;
le Seigneur m'avait exaucée ! L'un des médecins m'a demandé, tout à coup, si je
souffrais beaucoup, pour qui j'offrais mes souffrances et si je souffrais
volontairement. Il m'a demandé si je serais contente si le Seigneur, d'un moment
à l'autre, me libérait de mes douleurs. Je lui ai répondu qu'en vérité je
souffrais beaucoup, que j'endurais celles-ci pour l'amour de Dieu et pour la
conversion des pécheurs. Ils m'ont demandé quel était mon désir le plus grand.
J'ai répondu : « — Le Ciel. » Alors l’un d’eux m’a demandé si je désirais être
sainte, comme sainte Thérèse, comme sainte Claire, et bien d’autres, et être
mise sur les autels, en laissant comme elles une grande renommée dans le monde.
J'ai répondu : « — C'est ce qui m'intéresse le moins ! »
Voulant ébranler ma foi en Dieu, il m'a posé encore cette question : « — Si pour
sauver les pécheurs il était nécessaire de perdre ton âme, que ferais-tu ? » « —
J’ai pleinement confiance que la mienne serait sauvée, en sauvant celles des
autres ; mais si je devais la perdre, je dirais non à Notre Seigneur ; par
ailleurs, Il ne me demanderait jamais une pareille chose. Je peux toutefois dire
que j’ai offert au Seigneur mes yeux, qui sont ce que j’ai de plus cher dans mon
corps, si cela était nécessaire pour la conversion d’Hitler, de Staline et de
tous les autres fauteurs de guerre. »
— Et pourquoi ne manges-tu pas ?
— Je ne mange pas parce que je ne le peux pas ; je me sens rassasiée, je n’en
éprouve pas le besoin, par contre j’ai la nostalgie des aliments.
Après cela les médecins ont commencé l’examen que j’ai accepté dans une bonne
disposition. Ce fut un examen rigoureux, mais en même temps je dois dire qu’ils
ont usé de délicatesse envers mon pauvre corps.
A la fin, — étant donné que je n’étais pas en état de supporter un voyage —, ils
ont décidé de faire venir chez nous deux religieuses infirmières afin que
celles-ci s’assurent de la véracité de mon jeûne.
Quand les médecins sont partis, le Seigneur m’a fait comprendre que leurs
décisions ne se réaliseraient pas, et je suis restée alors dans l’attente de
leurs nouvelles et de leurs instructions.
Le 4 juin le médecin traitant et mon confesseur ordinaire
,
sont venus m’annoncer la décision des médecins, et me convaincre, moi et ma
famille, de l’opportunité d’aller au “Refuge de la Paralysie Enfantine” de Foz.
Je devais être placée dans une chambre sous surveillance, pendant un mois, pour
un contrôle plus direct de tout ce qui se passait en moi. Moi, sur le coup, j’ai
dit non, mais aussitôt je me suis avisée, pensant à l’obéissance que je devais à
l’Archevêque, et pour ne pas mettre dans une situation délicate mon directeur,
le docteur Azevedo et tous ceux qui s’intéressent à moi. J’ai donc accepté la
proposition, mais j’ai posé quelques conditions :
1 — pouvoir communier tous les jours ;
2 — d’être toujours accompagnée de ma sœur ;
3 — de ne plus être soumise à aucun autre examen, car je partais pour des
observations et non point pour des examens.
Pendant les jours où je suis encore restée à la maison, j’ai demandé à Jésus et
à la Maman du Ciel de me donner force et courage ainsi que force et courage pour
les miens, qui étaient désolés. Combien de fois, pendant la nuit, le cœur
oppressé et les larmes aux yeux, j’ai supplié Jésus de m’aider car j’avais
l’impression que toutes mes forces m’abandonnaient et que je me voyais sans
courage pour moi-même, et encore moins pour en insuffler aux autres !
Le 10 juin arriva et, tout était prêt pour le voyage vers l’hôpital de Foz do
Douro. Un immense chagrin s’empara de moi, mais en même temps un grand courage
m’est venu qui me permis de cacher tout ce qui se passait dans mon âme. Je
déposais toute ma confiance en Jésus, et j’étais si certaine de son aide divine,
que je pensais que s’il en était besoin, Il m’enverrait ses anges pour m’aider
dans l’exil où me voulaient les hommes.
Quand le médecin est arrivé pour me prendre, il n’a pas eu le courage de me dire
qu’il nous fallait partir ; c’est moi qui suis intervenue, lui disant : « —
Allons, docteur, pour revenir il nous faut partir ! »
Nous avons pris congé. Seul Notre Seigneur sait ce que m’a coûté la séparation
des miens qui, remplis de douleur, m’entouraient et m’embrassaient. Moi je ne
faisais que fixer le Cœur de Jésus et de la Petite-Maman pour leur demander de
la force.
En descendant les escaliers sur un brancard, j’ai dit aux miens, pour les
encourager : « — Courage ! Que tout ceci serve pour Jésus et pour les âmes ! »
Mais je n’ai rien pu dire d’autre, tellement mon cœur était oppressé, et aussi
pour retenir mes larmes. Il le fallait pour ne pas augmenter davantage leur
chagrin. À peine déposée dans l’ambulance, j’ai été entourée par une centaine de
personnes, qui avaient les larmes aux yeux. J’ai entendu aussi les sanglots de
ma mère et des autres parents. La douleur qu’alors j’ai éprouvée est indicible.
J’avais hâte de partir, et partir vite ; mon cœur battait si violemment que
j’avais l’impression qu’il me cassait les côtes. J’ai dit alors à Jésus : « —
Acceptez toutes les pulsations de mon cœur comme autant d’actes d’amour pour le
salut des âmes. »
Le voyage fut difficile. Je pensais que mon cœur n’y résisterait pas. De temps
en temps je regardais ma sœur ; elle était si abattue ! Le médecin disait qu’il
n’était pas difficile de voyager avec des malades comme moi parce qu’il me
voyait toujours souriante. Mais Jésus seul sait combien grandes étaient
l’amertume de mon cœur et les tourments de mon pauvre corps. À cause des
secousses de l’ambulance je me sentais déprimée, mais je répétais
inlassablement : « — Tout pour votre amour, Jésus ! Que l’obscurité de mon âme
puisse éclairer d’autres âmes ! »
 Près
des dernières maisons de Balasar, Monsieur Sampaio releva les rideaux de
l’ambulance. J’ai remarqué que le médecin avait les larmes aux yeux. Je lui ai
dit : « — Nous voilà bien ! » Et je lui ai demandé ce qui se passait. Il
m’expliqua alors que sur le bord de la route quelques enfants nous avaient jeté
des fleurs. Je me suis sentie toute attendrie et c’est avec peine que j’ai pu
retenir mes larmes. Quand nous sommes arrivés à Matosinhos, Près
des dernières maisons de Balasar, Monsieur Sampaio releva les rideaux de
l’ambulance. J’ai remarqué que le médecin avait les larmes aux yeux. Je lui ai
dit : « — Nous voilà bien ! » Et je lui ai demandé ce qui se passait. Il
m’expliqua alors que sur le bord de la route quelques enfants nous avaient jeté
des fleurs. Je me suis sentie toute attendrie et c’est avec peine que j’ai pu
retenir mes larmes. Quand nous sommes arrivés à Matosinhos,
le médecin décrocha les rideaux afin que je puisse regarder la mer. Un énorme
silence m’envahit et, en observant le continuel va-et-vient des vagues venant
mourir sur la plage, j’ai demandé à Jésus que mon amour, lui aussi, soit
continuel et permanent.
Arrivés près du “Refuge”, le docteur Gomes de Araujo s’opposa à ce que
l’ambulance s’avance jusqu’à la porte. Il chargea quelques hommes de prendre mon
brancard et de m’emmener ainsi, après m’avoir recouvert le visage afin que
personne ne me reconnaisse. Mon cœur s’est attristé davantage, me représentant
ce que ce serait de passer de longs dans un tel établissement. Ainsi recouverte
il me semblait être dans un cachot et je me demandais à moi-même : « — Quel
crime ai-je commis ? »
La montée des escaliers du “Refuge” m’a causé bien des peines car l’on me
portait la tête en bas. Ce ne fut qu’une fois dans ma chambre que mon visage fut
découvert. Là j’ai été entourée par le docteur Araujo et par quelques dames qui
devaient m’assister. Ensuite on m’a placée dans mon lit.
À ma sœur ils avaient attribué une autre chambre, contrairement à ce qui avait
été convenu. Ce fut l’un des plus grands sacrifices que l’on pouvait exiger de
moi : comment pouvais-je rester sans elle, elle qui savait comment me bouger
quand c’était nécessaire et m’aider avec de bonnes paroles qui m’étaient d’un
grand secours pour supporter mon douloureux calvaire.
À peine m’avait-on allongée sur le lit que Deolinda s’est présentée sur le seuil
de la porte avec la valise contenant le linge. Le docteur Araujo, la voyant,
hurla comme un forcené : « — Hors d’ici cette valise ! » Ce fut là une autre
épine parmi tant d’autres. Ensuite il commença à donner ses ordres : « —
Mesdames les assistantes, la malade peut dire tout ce qu’elle voudra, mais vous
n’êtes pas autorisées à lui poser des questions. »
Ces ordres ayant été donnés, il se retira et je suis restée seule avec le
médecin
et deux dames; celles-ci ayant été désignées pour rester en permanence auprès de
moi pour surveiller tous mes mouvements.
Quand, déjà il faisait nuit, le docteur Azevedo se préparait pour partir, je
n’ai pas pu retenir davantage les larmes. Lui, alors, bien plus qu’avec du
respect, avec tendresse pour ma douleur, il m’a dit : « — Ayez du courage !
Demain je reviendrai. »
Oui, j’ai pleuré malgré moi, mais j’ai offert mes larmes si amères à mon
Bien-Aimé Jésus. Me voyant ainsi désolée il fut admis que ma sœur reste dans ma
chambre avec l’une des surveillantes, afin qu’elle lui apprenne la façon de me
bouger. Mais il m’a été précisé de suite : « — Seulement cette nuit, jamais
plus ! »
Le lendemain, vendredi, commença pour moi, dans cette maison, un vrai calvaire.
À l’heure de l’extase, comme il arrive tous les vendredis, ma sœur est venue
auprès de moi ; mon médecin traitant, et une infirmière étaient aussi présents.
Aux observateurs présents, aucun détail n’a échappé, et tout a été divulgué et
commenté. Par exemple que monsieur Sampaio avait sorti sa montre…, que ma sœur
s’était agenouillée en entendant les paroles de l’extase… ; que l’une des
infirmières avait pleuré, etc. … Le docteur Azevedo, comme toujours, a écrit le
colloque de l’extase pour le remettre aux médecins. Deolinda, qui avait reçu
l’ordre de ne plus revenir dans ma chambre, était attristée et elle dit : « — Ne
pourrais-je voir ma sœur même si ce n’est que depuis le seuil de la porte de la
chambre ? Pensez-vous que mon regard puisse l’alimenter ? » Inclinée sur mon lit
elle pleurait, inconsolable.
Ce fut alors que je lui ai dit : « — Ne t’affliges pas, Notre Seigneur est avec
nous. » L’assistante qui avait pleuré pendant l’extase, lui tapant sur l’épaule
lui dit : « — Ne pleurez pas, le docteur Araujo est un homme d’une grande
charité ! » Il a suffi cette phrase à l’adresse de ma sœur pour que cette
assistante soit démise de ma surveillance ; nous ne l’avons revue que dans les
derniers jours, mais accompagnée, quand déjà ils avaient les preuves de la
vérité.
Ceci est arrivé à cause d’une assistante qui a été mon bourreau pendant toute la
durée de mon séjour à Foz. Elle ne peut pas s’imaginer ce qu’elle m’a fait
souffrir. Que le Seigneur lui pardonne.
Dans la nuit du vendredi au samedi j’ai eu l’une de ces crises de vomissements
qui me font tant souffrir. Cela m’a été d’autant plus pénible que je n’avais
personne pour me soutenir.
Le samedi le docteur Araujo est revenu pour voir comment j’allais et pour se
renseigner sur ce qui était arrivé. Ma prostration était telle que je ne me suis
même pas rendue compte quand il a frappé à la porte, toujours fermée à clef. Je
ne l’ai entendu que quand, tout près de moi, il susurrait à l’infirmière : « —
Elle est condamnée ! Elle est condamnée ! » A ces paroles j’ai ouvert les yeux
et je lui ai dit : « — Docteur, même chez moi j’ai de pareilles crises. » Il m’a
répondu immédiatement, d’un ton impérieux : « — Mademoiselle, ne croyez pas être
venue ici pour jeûner ! » J’ai compris ce qu’il voulait dire et je me suis
sentie profondément blessée.
Informé sur ce qui était arrivé le vendredi, il a voulu lire le récit de
l’extase et il commenta, furieux : « — Il paraît impossible que le docteur
Azevedo, si intelligent, se laisse séduire par de semblables choses ! Il faut en
finir avec tout ceci. En attendant, enlevons d’ici toutes les horloges afin que
cette malade ignore jusqu’à l’heure qu’il est » (Comme si le Seigneur avait
besoin d’horloge !).
Me voyant si fatiguée, il aurait voulu me soulager à l’aide de médicaments, mais
je m’y suis opposée. Combien de fois les infirmières se sont approchées de moi,
me croyant morte ! Cinq jours d’une continuelle agonie, davantage dans l’âme que
dans le corps, se sont passés. Pendant les crises de vomissements, ils ne
permettaient pas à Deolinda de venir à côté de moi, alors que chez nous,
parfois, deux personnes n’étaient pas de trop pour me tenir. Ils étaient tous
persuadés que les crises étaient dues au manque d’alimentation et que, ainsi
exilée et sans personnes qui ait pu me la procurer, j’aurais besoin de la
demander, sinon je mourrais. Comme ils se trompaient ! Ils ne savaient pas que
l’aliment me venait de la sainte Hostie que je recevais tous les jours.
En ces jours, mon médecin traitant est venu me voir et ma sœur, sans que je le
sache, l’a mis au courant de tout. Il est venu près de mon lit sans que je me
réveille ; l’infirmière lui suggéra que j’avais besoin de médecine. Ce fut à ce
moment-là que j’ai ouvert les yeux et que j’ai entendu ce qu’il lui répondait :
« — Cette malade est venue pour que l’on constate son jeûne et pour rien
d’autre. J’espère que le docteur Araujo respecte ces conditions. Je ne permets
pas qu’on lui fasse des piqûres ou n'importe quoi d’autre, à moins qu’elle ne le
demande elle-même. Vous verrez, les crises passeront, les cernes autour des yeux
disparaîtront, le teint et le pouls deviendront normaux, ou presque, car l’air
marin ne les favorise pas. Je vous assure d’une chose, madame : vous mourrez, je
mourrai, mais la malade ne mourra pas dans cet hôpital. »
Ensuite, assis à côté de moi, il me prodigua un peu de ce réconfort dont j’avais
tant besoin. Par la volonté de Dieu, cinq jours plus tard, les vomissements ont
cessé, le teint est redevenu normal, ainsi que la luminosité des yeux. Pendant
la visite suivante de mon médecin l’assistante le salua par cette phrase : « —
Regardez, docteur, regardez ce beau visage ! » Et le docteur de lui répondre
délicatement mais néanmoins fermement : « — C’est le résultat des côtelettes
qu’elle a mangé et des piqûres qu’elle a prises ! »
Jésus a bien voulu montrer encore une fois son pouvoir sur cette humble
créature. Toutes les assistantes accomplissaient scrupuleusement les consignes
du médecin et elles ne m’ont jamais abandonnée un seul instant. Elles
n’ouvraient la porte de la chambre que pour laisser entrer les médecins et les
infirmières.
En dépit de ma transformation, ni le médecin ni les infirmières voulaient se
convaincre que je pouvais vivre sans manger. En effet, ils utilisaient parfois
des arguments pour m’intimider: ils passaient ensuite aux phrases pleines de
tendresse et d’intérêt pour ma personne. Dans leurs discours je les ai entendues
dire que mon cas relevait de l’hystérie ou à un quelconque phénomène
inexplicable. Un jour j’ai raconté au docteur Dias de Azevedo tout ce que
j’avais dans mon âme si attristée : « Pour être traitée comme une hystérique je
n’ai pas besoin des rester là. Mais il m’a encouragée et m’a redonné confiance.
Je lui ai obéi pour faire en tout, la volonté de Dieu.
Le docteur Araujo venait me voir deux ou trois fois par jour, mais jamais à
la même heure. Je pense qu’il le faisait ainsi pour voir s’il découvrait quelque
chose. Une fois il est entré dans ma chambre la nuit, quand s’y trouvait
l’assistante que certains ont appelé du sobriquet de « cardinal-diable. »
Même si je vivais jusqu’à la fin du monde, je ne pourrais oublier l’impression
que j’éprouvais quand le docteur ouvrait et ensuite fermait immédiatement la
porte : je restais comme suspendue à ce qu’il avait dit. J’éprouvais une telle
impression que dans mon cœur et dans mon âme la tristesse augmentait. Combien de
fois je répétais à Jésus : « Que cette nuit puisse contribuer à donner de la
lumière à ceux qui m’entourent et à toutes les âmes qui vivent dans les
ténèbres. »
Lors des conversations et des interrogatoires, le docteur Araujo utilisait tous
les arguments possibles pour me convaincre de manger, me disant que Dieu n’était
pas content de mon jeûne. Il est a même essayé de me faire avoir des scrupules.
En outre, les infirmières ont essayé de me prendre par les sentiments. Avec
l’une des infirmières, il a également essayé de me faire perdre la foi. Il s’est
servi de tout ce que son intelligence avait de meilleur, me soumettant à des
interrogatoires interminables et torturants afin de me décourager, persuadé que
tout ce qui se passait en moi était dû à une influence humaine et non pas
divine. Si à chaque fois que j’étais interrogé j’avais l’impression de me
trouver en face d’un loup habillé en agneau, ce jour-là ce fut bien pire : il me
semblait voir en lui Satan lui-même qui, avec art et des sourires malins,
voulait m’ôter la foi et me convaincre que tout cela n’était qu’illusion.
Il me disait : « — Soyez convaincue, mademoiselle, que Dieu ne veut pas que vous
souffriez ! S’il veut sauver les autres, qu’il les sauve Lui-même, il en a le
pouvoir. S’il est vrai que Dieu récompense ceux qui souffrent, il n’y a pas de
récompense adéquate pour vous qui avez déjà trop souffert. »
Mais, mon Dieu, je sais que vous êtes infini, infini en pouvoir, infini dans les
récompenses.
S’il en était comme il me dit, pour qui je souffre ?
Il accompagnait ses paroles d’un regard malicieux, démoniaque — c’était
l’impression que j’avais. Je lui ai alors répondu :
« — Elles sont si grandes, si grandes les choses de Dieu ! Et nous, nous sommes
si petits, moi en tout cas ! » L’espace d’un instant il se tût, ensuite,
indigné, il s’est exclamé : « — Vous avez raison, mais moi, je suis une personne
bien plus grande ! » Et il est sorti.
Il était bien loin de connaître cette loi d’amour pour les âmes ! S’il avait
compris la valeur d’une âme, il verrait alors que tout ce que nous faisons n’est
jamais de trop pour les sauver.
Les humiliations et les sacrifices affluaient constamment. Si du moins j’avais
su bien les supporter, j’aurais tant eu à offrir à Jésus. On me présentait
toujours de nouvelles choses qui réclamaient de moi humiliations et sacrifices.
J’avais au pied de mon lit une photographie de Jacinta
de Fatima. Je la regardais avec amour et, sans craindre que les assistantes le
répètent au docteur, je soupirais : « — Chère Jacinta, malgré ton jeune âge, tu
as pu évaluer combien coûtent ces choses ! Du Ciel où tu demeures, aide-moi ! »
Seule l’aide du Ciel et les prières des âmes bonnes pourront me donner force
pour cheminer dans un si douloureux calvaire, et supporter le poids de cette
croix si pesante.
Toutes les fois que le docteur Gomes de Araujo entrait, il me tenait le même
discours et me laissait très épouvantée quand il me disait : « — Nous avons
beaucoup à parler. »
Quand je le voyais sortir, je respirais profondément et je me disais : “Béni
soit le Seigneur pour ton départ !” Mais la pensée qu’il reviendrait bientôt, me
procurait une très amère souffrance.
Un jour, assis à ma droite, il cherchait à me convaincre que j’étais dans
l’illusion. Il a commencé par un discours très vague sur la Médecine et sur l’un
de ses professeurs et d’un Collège de Porto, où il avait passé bien des heures,
pendant la nuit, à écrire un volumineux document et, convaincu qu’il avait
réussi son étude, il est allé retrouver son professeur pour lui faire part du
résultat de ses leçons. Le professeur lui disait : « — Êtes-vous sûr de ce que
vous avez écrit ? » Et il affirmait à chaque fois en être certain, pour telle et
telle raison. La conversation se prolongeait et moi je fixais le docteur faisant
semblant de ne pas comprendre où il voulait en venir, et je disais en moi-même :
« — Tu fais tant de détours pour arriver tout près ! » Mais le docteur
poursuivait : « — J’étais convaincu d’avoir fait un excellent travail ; le
professeur m’a laissé parler et ensuite m’a démontré que j’avais tort. Je suis
resté sans souffle : mon Dieu, tant d’heures de perdues ! Combien d’heures
d’illusion ! Ma longue étude s’était écroulée en quelques minutes ! » Moi qui
savais où il voulait en venir, je lui ai dit, à ce moment-là, en souriant : « —
Mais mon cas ne s’écroule pas, docteur ! J’ai été guidée par un directeur très
saint et très sage, et qui m’a étudiée pendant de longues années. Si l’œuvre est
de Dieu, personne ne la faire s’écrouler ! »
Le docteur, un peu embarrassé, faisant semblant que ce n’était pas celui-là le
but de ses paroles, a conclu : « — Ah non !... », essayant de me convaincre que
ce n’était pas là le sens de ses paroles, il s’est levé en hâte et sortit. Il en
était temps.
O mon Jésus, ce n’est qu’à vous que je peux me confier, mes larmes n’étaient que
pour vous. Je chantais avec le plus grand enthousiasme, mais au-dedans de moi et
dans mes yeux il semblait n’y avoir ni soleil ni jour. Pendant la nuit, quelques
fois, je me demandais : Que peut faire ma sœur, à cette heure-ci ?
Pleure-t-elle ?” Pensant qu’elle souffrait à cause de moi, une fois je n’ai pas
pu retenir mes larmes. Combien j’ai alors pleuré ! Je n’avais qu’une crainte :
déplaire à Jésus. Mais Lui, Il savait que j’acceptais tout par amour pour Lui,
avec un immense désir de Lui gagner des âmes. En effet, je Lui ai offert mes
larmes comme autant d’actes d’amour pour les Tabernacles. Plus la désolation est
grande, plus grand est aussi l’amour, n’est-ce pas ainsi, mon Jésus ? Acceptez
tout cela. Le seizième et le trentième jour de mon séjour, j’ai reçu la visite
de maman. J’avais une si grande envie de la voir ! Elle n’a pu rester que très
peu de temps avec moi et toujours sous le regard inquisiteur des surveillantes.
Elle pleurait et moi, je faisais semblant de ne pas avoir de chagrin : je lui
souriais, je plaisantais avec elle, je la cajolais, et avec mon sourire
trompeur,
je cachais la tristesse de mon âme, en retenant les larmes qui à tout prix
voulaient couler. Je l’ai encouragée, m’épanchant intérieurement avec Jésus.
C’était ma croix : ne devais-je pas la porter par amour de Jésus qui est mort
pour moi ?
Mes journées passaient ainsi, dans une continuelle lutte, entrecoupée seulement
par l’alternance des infirmières qui se succédaient selon la volonté du médecin.
À cause de certaines d’entre elles, j’ai beaucoup souffert, parce qu’elles
outrepassaient les limites de leurs droits et de leurs devoirs.
Le jour est arrivé où le docteur, convaincu désormais de la vérité,
permis un plus grand relâchement, autorisant pour quelque temps la venue de ma
sœur, même si toujours sous la surveillance de l’assistante. Il permit également
la visite, même si rapide, des sœurs Franciscaines du “Refuge”. Nous avions déjà
projeté de faire savoir à la maison la date de notre retour quand,
inopportunément surgit un contretemps.
L’une des infirmières surveillantes ayant parlé de mon cas à un certain médecin
qui ne me connaissait pas, et connaissait encore mon cas, a fait naître des
doutes.
Il s’est permis d’affirmer que ces choses-là étaient impossibles, que les
assistantes s’étaient fait berner et qu’il ne croirait qu’un envoyant auprès de
moi l’une de ses infirmières de confiance.
Le docteur Araujo, indigné par la méfiance manifestée vis-à-vis de ses
assistantes, lui imposa d’envoyer lui-même, auprès de moi, une personne plus
âgée, en qui il aurait entièrement confiance : il choisit sa propre sœur. Et
alors que nous pensions nous voir libérées de notre douleur, ce fut alors qu’une
nouvelle éprouve, bien plus triste et douloureuse, nous a été imposée.
Le docteur Araujo est venu nous convaincre de la nécessité de rester encore dix
jours. Ma sœur n’était pas d’accord, mais il insista argumentant qu’il était
nécessaire de convaincre l’autre médecin. J’ai dit alors à ma sœur : « — Quand
on y a passé trente jours, on peut bien y passer quarante. » Et l’affaire fut
ainsi réglée.
Le docteur Alvaro, en vérité, n’exigeait pas dix jours. Pour se convaincre il
lui suffisait que je reste quarante-huit heures de plus, sans manger ni rejeter.
 Mais
ce fut le docteur Araujo qui, délicatement, pour l’honneur de son nom, invita
l’assistante à rester un jour de plus, puis un autre jour. Mais
ce fut le docteur Araujo qui, délicatement, pour l’honneur de son nom, invita
l’assistante à rester un jour de plus, puis un autre jour.
Sa mission terminée, cette surveillante est revenue me voir plusieurs autres
fois, convaincue maintenant de la vérité. Cette dernière période fut un nouveau
calvaire que j’ai offert à Notre Seigneur et à la Petite-Maman: dure épreuve,
mon Dieu !
Le docteur Araujo, sans aucune explication, prit la bourse en caoutchouc que
j’avais sur l’estomac et une carafe d’eau que les assistantes conservaient pour
humidifier le mouchoir que je tenais sur le front, et versa dans les deux
récipients je ne sais quoi : si j’avais sucé le mouchoir ou bu de l’eau de la
bourse en caoutchouc, comme l’a dit par suite le docteur Alvaro, j’aurais eu des
indispositions qui leur auraient permis de s’en rendre compte. Il ordonna
ensuite aux assistantes de ne plus changer la glace de la bourse même si je le
demandais. Ses ordres ont été respectés, bien que la nouvelle assistante ait
essayé, à plusieurs reprises de changer la glace. Moi-même, je lui disais
quelquefois : « — Enlevez-moi la bourse quelques instants afin qu’elle
rafraîchisse, puis remettez-la-moi de nouveau. Il est nécessaire d’obéir aux
ordres du médecin. » Nous étions revenus au point de départ, sauf que bien plus
strict. Il a finalement été interdit de me parler de Jésus, car il pensait que
de cette façon il pourrait ôter ce que nous avons de plus intime en nous. Un
jour, le docteur m’a dit : « — Je n’admettrai pas que vous appeliez votre sœur
plus d’une fois la nuit. » La surveillante, plusieurs fois, comme pour me
tenter, et avec une intention tortueuse — c’est l’impression qu’elle me donnait
— me disait : « — Pauvre sainte, toujours dans cette même position ! Je vais
appeler votre sœur ! »
« — Je vous en remercie, madame, mais je ne le veux pas. Ce sont les ordres du
médecin : ma sœur ne doit venir qu’une seule fois ! »
Quand ma sœur toquait pour entrer, cette seule fois qui lui était permise par le
docteur, pour me changer de position, la nouvelle assistante allumait la lampe,
ouvrait la porte et se plaçait à côté de ma sœur. Aussitôt que celle-ci quittait
la chambre, l’assistante, simulant de la compassion envers moi, pour le froid
que j’aurais pu souffrir, et comme si elle raccommodait les draps et les
couvertures, me découvrait complètement pour voir si Deolinda n’avait rien
laissé dans le lit.
Je comprenais très bien son intention, mais sous prétexte de commodité, je
levais les bras au-dessus des coussins afin qu’elle puisse mieux faire son
inspection. « — Mon Jésus, tout et uniquement pour votre gloire ! »
Les séductions pour me faire manger quelque chose de son repas n’ont pas
manqué ! Elle me présentait un morceau, sans mot dire, et moi, je lui souriais.
Si l’invitation était verbale, je lui disais : « — Merci », mais toujours
souriante, faisant semblant de ne pas comprendre sa malice.
Combien de fois, pour mieux me surveiller, on m’a ôté les couvertures !
La nuit, particulièrement quand je ressentais davantage la solitude, le temps me
paraissait très long. Je sentais mon cœur, tel un arbre aux racines épaisses,
bien plantées dans le sol, et que la furie d’une grosse tempête arrachait, le
jetant à terre... Il me semblait que tout et tous me piétinaient. Même en
l’expliquant de la sorte, je sens que je ne dis rien de comparable à ce que j’ai
souffert. Encore aujourd’hui je revis dans ma mémoire ces choses-là et j’éprouve
un vrai tourment. Seul l’amour pour Jésus et pour les âmes me permet de
supporter une telle épreuve ! Quand je sentais s’approcher le docteur, je
disais : « — Voilà qu'arrive le bourreau qui vient visiter la pauvre prisonnière
par amour de Jésus et des âmes. Je n’ai offensé personne d’autre que vous, ô mon
Jésus, mais les hommes veulent, sans même s’en rendre compte, que de cette
façon, je paie mes ingratitudes ! »
En voyant ma sœur épouvantée parce que quelqu’un lui avait dit que mon échéance
était proche parce que je n’évacuais pas, j’ai cherché à lui redonner courage.
Pauvres hommes ! Jésus sait faire les choses bien mieux qu’eux !
La veille du départ fut un jour de visites. Tous les enfants du “Refuge” sont
passés devant moi. J’ai prié avec eux et je leur ai distribué des caramels.
Ma sœur ne semblait plus la même : tous s’en sont rendu compte. En plus des
enfants, environ mille cinq cents personnes sont venues me visiter... Les
policiers ont dû intervenir pour maintenir l’ordre. L’un d’eux s’est posté à
côté de moi, se contentant de répéter inlassablement : « En avant ! Allez,
allez, avancez ! »
Quelle impression que ce mouvement de foule ! Ni les suppliques de ma sœur ni
les policiers n’ont réussi à le contenir.
Le médecin lui-même, depuis la fenêtre, a dû intervenir pour que l’on arrête un
tel mouvement sinon on allait me tuer. Combien de personnes on pu pensé que la
malade était décédée ! Moi, en effet, je me sentais humiliée, las et exténuée,
ayant un sentiment de gêne pour les baisers que je recevais et les larmes que
l’on laissait tomber sur mon visage, comme signe d’une estime que je ne mérite
pas et que je ne veux pas.
Restée seule, j’ai d’abord demandé à ma sœur de me laver. Dans la matinée du
jour ne notre retour,
[103] le médecin, qui n’avait presque pas dormi vu sa
responsabilité, est venu au “Refuge” où beaucoup de monde attendait pour me
voir. Il est resté à côté de moi et a permis l’entrée de quelques personnes.
Puis il nous a dit que nous étions libres, que leurs observations étaient
terminées. Il autorisa ma sœur à manger dans ma chambre, puis ajouta : « — En
octobre je viendrai vous visiter à Balasar, non plus comme médecin espion, mais
comme un ami qui vous estime ».
Reconnaissante, j’ai baisé la main du docteur de Araujo et je l’ai remercié pour
son intérêt envers moi. Je l’ai fait avec sincérité, parce que, bien qu'il ait
été sévère et rude envers moi, il montra une attention sérieuse envers mon cas.
Dans l’après-midi de cette journée du 20 juillet, les religieuses et les
surveillantes sont venues me dire au revoir. Elles m’ont toutes fait des
cadeaux. Certaines sont même venues assister à mon départ. Alors que j’étais
déjà installée dans l’ambulance, l’une d’elles m’a aspergée de parfum, alors
qu’une autre dame m’a offert un bouquet d’œillets. Au cours du voyage j’ai reçu
quelques bouquets de fleurs. Je les ai acceptés par délicatesse, bien loin de
penser qu’ils seraient par la suite un prétexte à certains pour me faire
souffrir.
Ni le parfum, ni les fleurs n’ont été pour moi un motif de vanité. Quand,
pendant le voyage, nous nous arrêtions pour reposer, si je voyais que des gens
s’approchaient, par admiration pour moi, je disais à mon médecin traitant : « —
Ne nous arrêtons pas, docteur, allons plus loin. »
J’ai du être indélicate, mais lui, il s’est montré toujours d’une extrême
patience.
Je vivais davantage à l’intérieur qu’à l’extérieur de moi. La mer était tout ce
qui se présentait devant mes yeux, m’invitant au silence, au recueillement en
Dieu. Je n’avais pas de quoi être vaniteuse : tout ce qui m’arrivait était
plutôt motif d’humiliation, de me rendre si petite, minuscule. Qu’en serait-il
de moi si je devais être jugée par le monde ! On déposa tant de malice là où il
n’y en avait aucune. Pardonnez-leur, Jésus. Ils ne connaissent pas vos
méthodes !
Je me suis émue des larmes des surveillantes et des autres gens. Il a été
nécessaire de faire appel à la police pour contenir le peuple. Je suis sortie
joyeuse de cette maison bénie, pour avoir accompli mon devoir et parce que
j’allais rentrer, rencontrer les miens et ma chère petite chambre dont j’avais
la nostalgie. Quand je me suis retrouvée dans ma petite chambre, je croyais
rêver ! J’ai pleuré, mais des larmes de joie. Une fois déposée sur mon lit,
pendant bien longtemps, je n’ai plus permis que l’on me touche ; de continuels
gémissements m’échappaient, à cause des douleurs de plus en plus fortes, dues,
probablement au voyage.
Maintenant je me dis : Pourquoi me suis-je sacrifiée ? Par vanité, peut-être ?
Pauvre monde ! Vanité ? Pourquoi ? Que sommes-nous sans Dieu ? Qui pourrait
souffrir autant seulement par veine gloire ou par vanité ?
Quarante jours à Foz ! Dieu seul sait ce que j’y ai enduré, combien d’épines me
blessaient, combien de flèches plantées dans mon cœur ! Combien d’humiliations !
Combien d’humiliations !
Le docteur Azevedo avait raison quand, pendant le voyage aller, en me plaçant un
mouchoir humide sur le front, il me disait : « — Vous avez quelques cheveux
blancs, mais au voyage de retour, vous en aurez encore davantage. » Et, en
effet, c’est ce qui est arrivé : il avait déjà le pressentiment de ce qui
m’attendait. Mais il est si bon de tout supporter pour Jésus !
Appendice
Âgée de six ou sept ans je n’aimais pas rester sans rien faire, alors je
m’occupais à tout mettre
 en
ordre à la maison. J’aimais beaucoup aller laver le linge au bord de la rivière.
Quand je n’avais rien d’autre à laver, j’ôtais mon tablier et je le lavais. Je
m’occupais également à ranger le bois, faisant des rangées bien empilées et très
droites. en
ordre à la maison. J’aimais beaucoup aller laver le linge au bord de la rivière.
Quand je n’avais rien d’autre à laver, j’ôtais mon tablier et je le lavais. Je
m’occupais également à ranger le bois, faisant des rangées bien empilées et très
droites.
D’autres fois c’était dans le jardin que je travaillais, m’occupant des plantes
qui devaient fleurir que nous offrions ensuite pour embellir les autels de
l’église.
J’aimais que tout soit propre et bien ordonné, même quand j’étais malade.
Je n’aimais pas la saleté, alors je nettoyais tout, même le plus répugnant,
parce que cela me rendait joyeuse de voir ensuite que tout était impeccable.
Peu après notre retour de Póvoa de Varzim — où j’ai appris le peu que je sais —
nous sommes venues habiter au lieu-dit Calvário. La maison où nous vivons
n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. La cuisine était au sous-sol. Lors de la
première nuit que nous y avons passée, ma mère m’envoya vider à l’extérieur de
celle-ci une bassine d’eau. J’ai eu peur et c’est pour cela que j’ai refusé d’y
aller. Ma mère me gifla. Faisant preuve de mauvaise volonté, je n’ai jamais dit
à ma mère : je n’y vais pas. Dieu m’en garde ! Elle nous corrigeait sévèrement
et gare à nos oreilles !...
À l’âge de douze ans, Deolinda a commencé son cours de couturière. La première
pièce confectionnée, a été une chemise pour moi ; mais, par sa taille, ont
dirait plutôt une chemise de garçon. Moi, malgré mes neuf ans, je me suis moquée
d’elle. J’ai enfilé la chemise sur mes habits et je me suis rendue à la maison.
Ma sœur, riant à tout rompre, me suppliait : « — Enlève cette chemise ! Tu n’as
pas honte de te donner en spectacle de cette manière ? »
Je n’en ai pas tenu compte et... riant, moi aussi, j’ai parcouru les quelques
cinq cents mètres qui me séparaient de la maison.
A Sainte-Eulalie de Rio Covo (je devais avoir 11 ou 12 ans) vivaient mes oncles,
qui sont tombés malades, atteints par la fièvre espagnole. Ma grand-mère, puis
ma mère se sont relayées pour les secourir, mais elles aussi ont été atteintes
par la maladie. Alors, encore que nous soyons bien jeunes, nous y sommes allées,
ma sœur et moi.
Une nuit, mon oncle est mort. Nous y sommes restées jusqu’à la Messe du septième
jour.
Une fois, il a fallu aller chercher du riz, mais en traversant la chambre où se
trouvait le corps de mon oncle. Arrivée au seuil de la porte, la peur m’a
envahie; je n’ai pas eu le courage d’y entrer; il a fallu que ma grand-mère
m’accompagne. L’autre soir j’ai été chargée de fermer la fenêtre de cette même
chambre. Arrivée dans la salle contiguë de celle-ci, je me suis encouragée
moi-même, me disant : « — Je dois vaincre la peur. » — Et, ce disant, en
marchand doucement, j’ai ouvert la porte et je me suis rendue dans la chambre où
se trouvait la dépouille de mon oncle. Depuis lors, je n’ai plus jamais eu peur:
j’avais vaincu de ma peur.
Lorsque j’avais mes douze ou treize ans, j’étais assez forte. Je me souviens
qu’un jour, un homme se ventait devant quelques jeunes filles d’être très
robuste. Je me suis lancée contre lui, qui ne s’y attendait pas, et je l’ai
attrapé et mis par terre. Il s’est mis à crier : « Laisse-moi ! Laisse-moi ! ».
Je ne l’ai laissé que quand j’ai bien voulu : mon but était uniquement celui
d’obtenir que lui, étant un homme, puisse montrer la force dont il se ventait.
Vers les 13 ans j’ai du gifler lourdement un homme marié qui m’avait adressé des
paroles indécentes… J’ai tourné le dos à un jeune homme riche qui m’attendait à
un endroit solitaire, par où je devais passer, pour me parler d’amour.
Âgée de quatorze ans, j’aimais assister les moribonds. Je me souviens des cas
d’un pauvre homme qui était aux portes de la mort et d’une jeune fille mon amie.
Je suis allée visiter cet homme et je l’ai trouvé recouvert de haillons.
Aussitôt j’ai couru chez moi et j’ai demandé à ma mère de lui prêter des
couvertures. Elle me les prêta volontiers. Toute heureuse, je les ai emportées
et je suis restée pour tenir compagnie à la fille du malade, lequel a vécu
encore douze jours. Pendant ce temps, un homme est venu demander du bois à la
jeune fille, mais elle n’en avait pas. Alors l’homme commença à l’insulter. J’ai
dit alors : « — Elle n’a pas eu le temps d’aller en chercher, que peut elle y
faire ? » L’homme me dit ensuite : « — Si je ne tenais pas compte de la
générosité de ta mère, je te mettrais volontiers deux bonnes gifles ! » Mais il
ne l’a pas fait, parce que je me suis tue. Autrement, il mes les aurait mises
et, moi, j’en aurais été pour mes frais…
Une fille est venue, un jour nous informer que l’une de ses voisines était sur
le point de mourir. Ma sœur a pris son livre de prières, de l’eau bénite et s’en
est allée rapidement chez la malade. Deux de ses élèves l’accompagnaient.
Deolinda a commencé la prière pour obtenir une bonne mort. Elle était si
émotionnée, qu’elle tremblait. Les prières terminées, la dame est décédée. Alors
Deolinda nous a dit : « — J’ai fait ce que j’ai pu ; je n’ai pas le courage d’en
faire davantage. » J’ai vu la fille près de sa mère morte. La petite-fille pris
la fuite et je n’ai pas eu le courage de la laisser toute seule. Je suis restée
pour l’aider à laver et à habiller la dépouille mortelle qui était couverte de
plaies et exhalait une odeur répugnante. Je croyais que d’un moment à l’autre
j’allais m’évanouir. Une dame qui était aussi dans la chambre, a remarqué mon
malaise et est sortie dans le jardin chercher quelques feuilles parfumées pour
me les faire sentir. Je n’en suis repartie que lorsque tout a été en ordre.
À l’âge de 16 ans, déjà malade, je suis allée à la maison où ma sœur faisait la
couture. Ayant trouvé, suspendu, un habit d’homme, je l’ai enfilé et, dans cet
accoutrement, je me suis présentée devant ma sœur et de la maîtresse de maison.
Elles ont rigolé de bon cœur. La dame me suggéra : « — Tiens, va dans la rue
habillée de la sorte, car mes enfants et mon mari sont en train de tailler la
vigne par-dessus le mur d’enceinte ». J’ai pensé qu’ils me reconnaîtraient, mais
j’y suis allée. Ils ne m’ont pas reconnue et, très étonnés, ils s’arrêtèrent de
travailler, afin de voir s’ils connaissaient le jeune homme. Ma sœur et la
maîtresse de maison, de la fenêtre, suivaient la scène, et riaient aux éclats.
Entre mes dix-sept et mes dix-huit ans, moi et ma sœur nous sommes parties à
Aldreu, afin de confectionner des fleurs artificielles pour le compte des
zélatrices et à la demande de Monsieur le curé. J’étais déjà malade. J’y suis
allée pour aider Deolinda, afin que nous revenions plus vite. Nous avons été
hébergées chez le Curé. Deux jeunes hommes du côté de Viana y sont allés et ils
voulaient flirter avec Deolinda, ceci juste la veille de notre retour. Ils ont
demandé au Curé si l’on pouvait jouer les cartes. Nous nous sommes installés
près de la cheminée et nous avons discuté pendant que nous jouions. Le Curé,
quand il nous a vu, s’est adressé aux deux garçons et leur dit : « — Ah ! Ah !
Alors, je suis là depuis quatre ans et vous n’êtes jamais venus ici faire une
partie, mais aujourd’hui vous êtes là ? »
La nuit suivante, lorsque nous devions revenir chez nous, il y eut un violent
orage et, avec la pluie, il y avait de boue partout. Étant fort malade, la nièce
du Curé m’a prêté une paire de sabots et ma sœur est revenue pieds nus. Un quart
d’heure après notre départ, la pluie a reprit. Le sang coulait de mes pieds, non
seulement à cause des sabots qui n’étaient pas faits pour moi, mais aussi parce
que mes pieds étaient délicats, car cela faisait bien longtemps que je ne me
déchaussais pas. Les douleurs étaient véhémentes et, à la fin, j’ai dû marcher
pieds nus, et ainsi me mouiller. Quand nous sommes arrivées en gare, le train
venait de passer depuis cinq minutes. Ma sœur se mit à pleurer en voyant mon
état. Il était alors neuf heures du matin. Le prochain train était à onze
heures, mais il ne s’arrêtait qu’à Barcelos, ce n’était le meilleur pour nous.
Nous avons attendu dans la gare. Deux professeurs de Aldreu sont passés et nous
ont invité à prendre un café. Nous n’avons repris notre chemin de retour que
plus tard, arrivant enfin chez notre tante à Sainte-Eulalie. Elle nous a préparé
un bon repas et ne voulait pas que nous repartions, parce qu’il était déjà tard
et que nous étions fatiguées. Nous nous sommes entêtées et lui avons promis que
nous ne viendrions que jusqu’à Chorente, où demeurait notre tante Felismina. De
là nous sommes revenues à Balasar, où nous sommes arrivées tard la nuit. Nous
avons frappé à la porte, mais maman n’était pas à la maison. Une voisine nous a
dit : « — Écoutez, madame Mathilde est mourante, votre mère y était. » Le
lendemain je suis allée chez la moribonde. L’une de ses nièces m’a dit : « —
J’aurais tant besoin d’aller chez moi… » J’ai répondu : « — Vas y, je reste. »
Et elle de me demander : « — Et tu n’as pas peur ? » « — Non, je n’ai aucune
peur ». Peu de temps après madame Mathilde agonisait. J’ai prié ce que je
pensais être adéquat à la situation, mais je n’ai ressenti la moindre peur.

Le Père Leopoldino, nouveau curé, continuera à lui apporter la Communion
presque tous les jours, jusqu’au jour de sa mort, le 13 octobre 1955.
Deolinda témoigna: “Je me souviens en tout cas
de ceci: que ma sœur n’a jamais vomi la communion, lors de ses crises de
vomissements, fréquentes et violentes. Il suffisait que Jésus arrive
dans sa chambre pour que les vomissements cessent et ne reviennent que
bien plus tard. Ceci arriva aussi à Foz, quand elle y fut conduite pour
subir des contrôles médicaux. Je me souviens encore, quand en 1937,
alors que l’on pensait qu’elle allait mourir, à cause de ses
vomissements très forts, monsieur le Curé lui administra la Communion. A
genoux, à côté d’elle, je l’avais vu vomir une hostie non consacrée que
l’abbé lui avait donnée, j’avais grande peur qu’elle ne vomit aussi
Jésus. Mais, grâce à Dieu, cela n’arriva pas. Par la suite, je ne m’en
suis plus préoccupée”.
Deolinda témoigne: “Un dimanche nous sommes allées à l’église et nous
avons laissé la porta entrouverte, car les pluies hivernales, l’avaient
fait gonfler. A notre retour, Alexandrina nous demanda: — Je ne veux
plus rester toute seule, car le «forgeron» — sobriquet donné à un
certain Teixeira — est venu. Je l’ai entendu arriver et crier pour que
je lui ouvre. Il a essayé plus d’une fois, mais la porte ne s’est pas
ouverte”.
Sobriquet qu’elle donnait au démon.
Felizmina Martins dos Santos confirma cet état d’Alexandrina, en
ajoutant que quelques fois, avec Deolinda, elles étaient obligées
d’étouffer, par des chants, certains hurlements qui pouvaient être
entendus dans la rue par les passants. Dans la vie de sainte Gemma Galgani, on peu
lire des phénomènes du même genre.
Le démon se servait de la langue d’Alexandrina pour prononcer des mots
indécents, qu’elle même ne connaissait pas.
Le Père Mariano Pinho témoigne: “Le 7 octobre 1937, j’ai assisté,
avec ceux de la maison, à une de ces lutes terribles”. Voir aussi,
le livre « Sous le Ciel de Balasar » écrit par le même prêtre et
où ces attaques diaboliques sont décrites en détail.
Journal du 25 juillet 1938.
Le 3 octobre 1938. Jour de la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Après les tourments de la première passion, Alexandrina sentit le besoin
d’exprimer ses sentiments de reconnaissance au Seigneur. Elle a écrit
elle-même, ce soir-là, sur une image cette pensée:
“Jésus m’a conduite du Jardin des Oliviers au Calvaire.
Quel grand bonheur! Maintenant je peux dire: je suis crucifiée avec le
Christ”.
Alexandrina considérait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus comme sœur
spirituelle: ce jour-là, c’était sa fête liturgique.
La sœur de la Servante de Dieu.
Deolinda témoigne: «En 1938, pendant quelques jours, ma sœur souffrit
d’une soif brûlante, inextinguible. Elle nous disait: — “De l’eau,
beaucoup d’eau! Des sceaux d’eau!” — Nous avons alors prit un récipient,
nous y avons appliqué un tuyau en caoutchouc par où s’écoulait un petit
filet d’eau, laquelle, après avoir touché ses lèvres, retombait dans un
autre récipient. Jour et nuit, sans aucune interruption, nous avons du
utilisé, en effet, des sceaux d’eau».
Pour comprendre cette phase importante de la vie d’Alexandrina, il est
nécessaire de lire “Le Château intérieur”, sixième mansion, de
sainte Thérèse d’Avila.
Pendant la Passion, Alexandrina ne voyait rien d’autre et n’entendait
rien d’autre, sauf les ordres donnés par son directeur spirituel; y
compris si celles-ci n’étaient données que par la pensée. Elle obéissait
aussi aux ordres de toute personne mandatée par son Père spirituel.
Les jésuites, confrères et les supérieurs du Père Mariano Pinho, crurent
à l’hystérie et peut-être aussi à la mystification de la part d’Alexandrina:
de là les souffrances du Père Mariano Pinho.
L’avis unanime des prêtres était celui-ci: “Que l’on fasse appel aux
médecins”, car, en effet, les mouvements accomplis par Alexandrina,
lors de la Passion, les laissaient dubitatifs, quand on sait que la
servante de Dieu était devenue paralytique et ne pouvait donc pas se
mouvoir. Pendant la Passion, elle faisait tous les mouvements — et sans
l’aide de personne! — relatifs aux divers moments de la Passion du
Seigneur: agonie, tribunaux, chutes lors du chemin de Croix, etc. .
La distance séparant Balasar de Porto est d’environ 50 kilomètres.
Deolinda témoigne: “Un médecin de Porto, pour l’examiner, la fit
déshabiller complètement, en lui disant: — «Soyez tranquille, j’ai déjà
perdue toute ma pudeur» — Alexandrina, lui répondit immédiatement: — «Si
vous, vous l’avez perdue, moi pas!” — Cet incident explique
l’accroissement des souffrances dont parle Alexandrina.
Le chanoine Manuel Pereira Vilar, est devenu un grand ami d’Alexandrina.
L’un des plus grands neurologues du Portugal.
Monsieur Antonio Sampaio de Trofa.
Sauf pendant les extases de la Passion, où elle n’avait pas besoin
d’aide pour accomplir tous les gestes et déplacements.
C’est pourquoi il (le Père Terças) ne pouvais pas attendre la réponse du
Père Mariano Pinho, directeur d’Alexandrina.
Cette publication eût pour résultat de mettre le Père Mariano Pinho dans
une situation peu confortable vis à vis de ses collègues jésuites,
lesquels sont allés jusqu’à publier dans leur revue “Brotéria” un
article assez virulent contre le “cas de Balasar” et, ceci sans la
moindre enquête.
Le Dr. Azevedo communiqua au Père Mariano Pinho la nouvelle décision:
“Les médecins sont resté bien impressionnés, mais dernièrement, et
contre ce qui avait été convenu, ils exigent, pour un jugement
définitif, que notre infirme soit internée dans une maison de santé. Ils
ont affirmé que c’était là l’avis de plusieurs de leurs collègues... et
qu’ils ne voulaient pas compromettre leur renommée.” (31 mai 1943).
Et quelques jours plus tard: “... Alexandrina craignait,
initialement, que son départ puisse compromettre la santé de la mère...
Puis elle consentit à l’internement à Foz. Aujourd’hui je suis allé à
Porto et il a été convenu de l’interner au « Refuge » pendant quelques
jours. Je leur ai demandé, et eux ils m’ont promis, de contrôler
uniquement les facultés mentales de la malade et le jeûne, mais sans la
bouger... Ce qui nous intéresse c’est la survie sans alimentation.” (4
juin 1943).
Le 6 juin il informe Alexandrina: “... Nous avons convenu
de vous transporter à Foz la semaine prochaine... Nul ne vous touchera
sans que je sois présent et sans mon autorisation. Tout d’abord nous
vérifierons le jeûne absolu qui est ce qui nous intéresse pour le
rapport... Au sujet de Deolinda il a été convenu qu’elle vous
accompagnera à condition qu’elle ne sorte pas du « Refuge » (qu’elle
n’ai pas l’idée de sortir en ville cherchez des aliments pour sa sœur).
Il vaut mieux de prendre ceci comme une plaisanterie afin de ne pas nous
avilir.”
Alexandrina a toujours eu des souffrances soit physiques soit morales à
tel point qu’elle dit un jour à Dom Umberto: “J’ai tant souffert dans ma
vie que, en y repensant, il me semble ne pas avoir eu aucun jour sans
douleurs... Il n’existe pas dans mon corps aucun le moindre endroit qui
n’ai pas souffert”.
Malgré cela, elle avait toujours le sourire et chantait.
Le docteur Azevedo, à la date du 4 juillet, écrivait au Père Mariano
Pinho : “... La malade est depuis le 10 juin sous observation jour et
nuit: son abstinence (de solides et liquides) a été vérifiée, elle n’a
produit la moindre goutte d’urine; elle conserve le même poids et ses
facultés sont très lucides...” Puis le 12 du même mois: “Le jeûne a été
absolu, les analyses de sang normales... Les médecins affirment que chez
Alexandrina le surnaturel est évident”.
Il est en effet venu, comme il l’avait promis.
“Certaines personnes se sont scandalisées parce que d’autres offraient
des fleurs à Alexandrina: la chose fut même commentée par des prêtres
qui ont réprouvé cette popularité, et considéré comme une preuve de
faiblesse de la part de la servante de Dieu.” (Lettre de Deolinda au
Père Umberto du 22 novembre 1971).
Il est bon de signaler que les routes portugaises, à ce temps-là,
étaient très mauvaises et mal entretenues, particulièrement les
secondaires qui reliaient les petits villages entre eux.
|





 |
